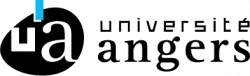Dans son édito d’aujourd’hui sur Euradionantes, Albrecht se pose une question simple : faut-il s’intéresser aux élections en Turquie dimanche prochain ? Et il y répond par un « oui » sans équivoque.
Exactement. Il y a plusieurs bonnes raisons de regarder ces scrutins – à la fois parlementaire et présidentiel – de très près.
Les médias parlent beaucoup, et à juste titre, du Président Erdoğan et de ses manœuvres visant à renforcer, à accroître et à pérenniser ses pouvoirs. Et cette fois-ci, ils parlent aussi du renouvellement de l’opposition qui, pour la première fois depuis plus de quinze ans, semble en mesure de menacer ce pouvoir malgré une campagne électorale marquée une fois de plus par un déséquilibre honteux en matière de couverture médiatique.
Mais au-delà de la question de savoir si Erdoğan parvient encore une fois, malgré la crise économique qui se fait sentir, à tirer son épingle du jeu, ou si au contraire, il perd sa majorité parlementaire et sera obligé d’affronter un adversaire sérieux au deuxième tour des présidentielles programmé le 8 juillet prochain, il y a des tendances fortes dans l’opinion publique turque qui méritent que nous nous y attardions.

Vous êtes donc, ces derniers jours, allés à la pêche aux explications auprès d’universitaires turcs, entre Istanbul et Ankara. Qu’en disent-ils, de cette opinion publique ?
Eh bien, ce qui frappe le plus les esprits, c’est le climat de polarisation exacerbée, presque grotesque, qui caractérise la société turque aujourd’hui.
On m’a donné à lire une étude récente du Centre de recherche sur les migrations de l’Université Bilgi d’Istanbul, qui met en lumière le caractère hautement émotionnel de cette polarisation. En appliquant des outils de la psychologie sociale comme « l’échelle de distance sociale » selon Bogardus ou la mesure du « degré de supériorité morale » ressenti et déclaré par rapport aux différents adversaires politiques, on comprend que l’hostilité réciproque entre les groupes de sympathisants des différents partis politiques atteint désormais des sommets, et elle est nourrie en permanence par des médias tout aussi polarisés et polarisants.
Pour décrire les résultats de cette étude dans mon édito, j’ai désespérément cherché un autre mot que « de la haine » mais je n’en ai pas trouvé, et cela n’annonce rien de bien pour le lendemain des élections.
Pourquoi ? Que pourrait-il se passer ?
 Selon le Professeur Özgehan Şenyuva, politologue à la Middle East Technical University d’Ankara, cette polarisation à l’excès a plusieurs conséquences directes. Elle nourrit les théories de complot les plus absurdes, pérennise une atmosphère de soupçon généralisé de tous envers tous, et elle a d’ores et déjà tué le « consentement du perdant », cet élément essentiel de la légitimité de toute majorité démocratiquement élue, lubrifiant indispensable de la transition entre la campagne électorale et la mandature du nouveau gouvernement.
Selon le Professeur Özgehan Şenyuva, politologue à la Middle East Technical University d’Ankara, cette polarisation à l’excès a plusieurs conséquences directes. Elle nourrit les théories de complot les plus absurdes, pérennise une atmosphère de soupçon généralisé de tous envers tous, et elle a d’ores et déjà tué le « consentement du perdant », cet élément essentiel de la légitimité de toute majorité démocratiquement élue, lubrifiant indispensable de la transition entre la campagne électorale et la mandature du nouveau gouvernement.
Pour le Professeur Şenyuva, dans un tel climat empoisonné depuis des années, il n’est pas à exclure, surtout en cas de défaite de l’AKP, le parti du Président Erdoğan, que ce dernier refuse de reconnaître les résultats, dénonce un genre de « coup d’Etat » contre lui et appelle ses supporters à défendre le régime dans la rue.
Mais y a-t-il encore des sujets sur lesquels les Turcs tombent d’accord, au-delà de ces clivages politiques abyssaux ?
Oui, il y en a. Trois, pour être plus précis. Özgehan Şenyuva les appelle les « îlots de consensus négatif » dans un océan d’antagonismes et d’hostilité entre les groupes politiques.
D’abord, le rejet massif de réfugiés syriens, auquel l’Europe a sans le moindre doute participé en poussant le gouvernement Erdoğan, contre monnaie trébuchante, à mettre en place d’immenses camps d’hébergement pour les arrivants en provenance du pays voisin. Selon les affinités politiques, ils sont entre 75% et 95% des Turcs à souhaiter qu’on les renvoie dans leur pays d’origine.
Ensuite, c’est l’anti-Américanisme qui fait consensus. L’année dernière déjà, une enquête globale du PEW Research Center avait placé la Turquie deuxième dans le monde pour leur opinion défavorable des Etats-Unis, avec un taux de 79%. Ces jours-ci, une enquête d’une autre université turque, la Kadir Has à Istanbul, montre que près des deux tiers des Turcs considèrent les Etats-Unis comme une « menace » pour leur pays. Ceux qui considèrent ce partenaire clé au sein de l’OTAN comme « le meilleur ami » de la Turquie sont très exactement 0,6%. Trump a beau courtiser les autocrates tendance dictateur, il lui reste du boulot.
Enfin, il y a la méfiance envers l’Europe, dans laquelle se retrouvent beaucoup de Turcs, quelle que soit leur couleur politique.
Certes, ils restent 55% à souhaiter en principe que leur pays devienne membre de l’Union européenne, mais 71% à considérer que cela n’adviendra en fait jamais. Parmi les deux tiers qui estiment que le processus d’adhésion de la Turquie est intentionnellement « bloqué » par les Etats-membres européens, ils sont 59% à être convaincus que c’est le cas pour des questions religieuses ou identitaires. Il n’y a plus que 19% qui choisissent, pour caractériser la Turquie, l’expression « pays européen ». En 2017 ou 2016, ils avaient encore été un tiers à réclamer cette appartenance européenne, c’est un déclin de 40%.
Pour Özgehan Şenyuva, c’est justement le résultat de la polarisation à outrance induite par Erdoğan, une polarisation qui exploite et aggrave les peurs contemporaines et qui mène inexorablement vers la dénonciation de « boucs émissaires » étrangers.
En France, notre démocratie n’en est pas encore là. Mais nous ne sommes pas à l’abri de glisser vers la diabolisation rhétorique de l’adversaire politique et de l’autre tout court. Raison de plus de regarder attentivement ce qui se passe chez les autres.