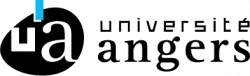Par Petr Kaniok
Aujourd’hui et demain, les électeurs tchèques se rendront aux urnes. Comme tous les quatre ans, ils décideront de l’avenir de « Czechia » (selon le nouveau nom international que voudrait se donner, avec plus ou moins de réussite, la petite république au centre de l’Europe). Et une fois de plus, les élections sont qualifiées d’« importantes », voire « décisives » par les médias tchèques, mais aussi plus d’un homme politique.

Si je dis « une fois de plus », c’est que ce n’est pas la première fois. Durant les sept dernières années, la politique tchèque a énormément changé. De stable en instable. De prévisible en chaotique. Et de plutôt modérée en populiste. Comment cela a pu se produire ?
Il était une fois un petit pays au cœur même du continent européen. Jusqu’en 2010, ce fut un pays remarquablement stable, notamment depuis son divorce “de velours”, en janvier 1993, avec son voisin slovaque après 80 ans de mariage. Alors que dans ses pays voisins, des formations politiques naissaient pour disparaître souvent au cours d’une seule législative, le paysage politique du petit pays tchèque était gentiment ennuyeux, avec au grand maximum cinq ou six partis et une alternance standard entre le centre-droite et le centre-gauche. Même les nouveaux arrivants – comme les Verts en 2006 – étaient des partis traditionnels dans le sens où ils représentaient un ensemble cohérent d’idées et d’objectifs.
Puis, tout a changé aux élections de 2010. Depuis, la politique tchèque est devenue une autre histoire. Pas en bien pour le pays.
Comme souvent, il faut chercher du côté de l’histoire pour comprendre le « pourquoi ». Même si 2010 peut être considéré comme un moment charnière, les causes profondes du « séisme électoral » étaient apparues dès les années 1990. A cette époque, la transition tchèque – notamment dans sa dimension économique – avait l’air d’une vraie réussite. Durant la campagne 1996, Václav Klaus, leader emblématique de la Tchéquie moderne, s’en réclamait avec son slogan « Nous avons fait nos preuves». En revanche, les électeurs ne furent pas convaincus et donnèrent massivement leurs voix à l’opposition. Le résultat permit à Klaus de former une seconde coalition de gouvernement, mais ce fut un gouvernement de minorité, faible, qui dut démissionner après seulement un an et demi au pouvoir.
Les élections anticipées qui s’ensuivirent ne parvinrent pas non plus à dégager une majorité, mais cette fois-ci, le gouvernement fut formé par les Sociaux-Démocrates, et Miloš Zeman, un autre personnage clé de la politique tchèque, en devint le Premier ministre. Ce qui n’avait rien de tragique en soi, mais son cabinet fut soutenu dans un soi-disant « accord d’opposition » par les « Démocrates Civiques » de Václav Klaus, pourtant son premier rival et ennemi juré. Voilà le péché originel de la démocratie tchèque : une pseudo-coalition et une pseudo-opposition, pour laquelle Klaus et Zeman ne sont pas seuls à porter la responsabilité, puisque les autres partis se montrèrent incapables de trouver une solution alternative, blessant profondément les électeurs des partis traditionnels. Elle a laissé une cicatrice qui ne s’est jamais refermée.
Un deuxième péché a été commis dans les années 1990 : la décentralisation. L’idée même de créer des régions et de leur attribuer certaines compétences – l’éducation, le développement régional, la santé – n’est bien sûr pas mauvaise en soi, et elle fut soutenue par la majorité des partis politiques. Ceci dit, dès que les régions ont obtenu le pouvoir de gérer l’argent en provenance des fonds structurels européens, de gros problèmes sont apparus. A partir de 2006 notamment, presque chaque région tchèque a eu droit à son scandale de corruption. Ces derniers étaient généralement liés, de manière directe ou indirecte, à des projets co-financés par les fonds structurels, touchant le plus souvent des politiques régionales issus soit des Démocrates Civiques, soit des Sociaux-Démocrates. La régionalisation de l’aide européenne a ainsi mené à des magouilles entre les hommes forts des nouvelles administrations régionales et leurs amis du monde des affaires – impossibles à contrôler depuis les sièges des deux partis. L’existence de ces personnages douteux – pour qui le terme « parrains » est largement partagé – a été un autre clou dans le cercueil des partis traditionnels.
Il y a certes eu d’autres causes internationales et contextuelles pour le grand changement dans la politique tchèque – la présidence européenne tragicomique de 2009, par exemple, et la crise financière. Mais les dynamiques du séisme de 2010 ou encore l’arrivée des populistes au parlement se sont trouvés au sein même du système à devoir expliquer les erreurs commises par les leaders politiques du pays. Un parti nommé « Affaires Publiques » eut du succès avec une campagne axée sur le slogan « Nous dégagerons les dinosaures politiques » et rentra au gouvernement. Et même si ce parti se montra vite inapte et éclata après trois ans, son succès initial a ouvert la boîte de Pandore au populisme.

En 2013, lors des élections anticipées, l’appel populistes a été repris de manière fortement efficace par d’autres partis émergents : l’« Action des Citoyens Mécontents » (connu sous l’acronyme « ANO ») et la droite populiste de l’« Aube de la Démocratie Directe ». Le premier de ces deux mouvements, dont le leader (et propriétaire, il convient de préciser) est Andrej Babiš, l’un des businessman les plus riches du pays, utilisa le slogan « Nous ne sommes pas comme les politiques, nous travaillons dur », alors que le deuxième fit la promotion de la démocratie directe comme remède universel contre tout ce qui n’allait pas dans la République.
C’est surtout ANO qui réussit son coup. Succédant à « Affaires Publiques », sans commettre les mêmes erreurs, il entra au gouvernement et est aujourd’hui la première force politique du pays. En 2017, la question principale n’est pas qui va gagner, mais simplement quel nombre de sièges sera raflé par ANO et combien de partenaire il lui faudra pour former une majorité dans l’assemblée. Les derniers sondages accordent tout juste 10 à 12% des votes pour les deux grands partis traditionnels… En fait, ils se battent désormais avec les autres « petits » partis et les nouveaux arrivants, comme « Les Pirates », l’étoile montante de la politique thèque.
Notre système électoral est basé sur le scrutin proportionnel avec un seuil de 5% pour entrer dans l’assemblée. Cependant, comme les sièges sont distribués dans les treize régions plus Prague, il possède aussi une composante majoritaire qui se voit même renforcée par l’application de la « méthode d’Hondt » pour calculer le nombre de mandats. Il en résulte qu’un parti doté de d’environ 30% des voix peut avoir 40% ou plus des sièges dans l’assemblée, en fonction de combien de votes tomberont sous le seuil des 5% et seront ensuite distribué parmi les partis qualifiés.
A part la victoire d’ANO, les résultats de la semaine prochaine sont difficiles à prévoir. La campagne n’est pas particulièrement intensive et manque de thèmes forts. Les partis traditionnels tentent de faire paraître Monsieur Babiš comme un oligarque dangereux et dictateur en puissance, mais ils manquent de proposer un agenda positif et intéressant de leur côté. Un autre problème est le manque de leaders charismatiques, un must de nos jours.
Conclusion : ce qu’il faut attendre comme résultat principal des élections tchèques de 2017 est, d’une part, une instabilité encore accrue au sein du paysage politique et, d’autre part, un renforcement des tendances populistes en son sein.