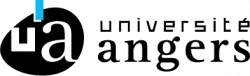En cette journée d’ouverture de la coupe du monde de Football en Russie, Albrecht Sonntag nous parle des relations plurielles au sein de cette discipline, à l’heure où de plus en plus de joueurs ont plusieurs racines.
Le football et le monde politique qui nous entoure entretiennent des liens étranges. Ensemble, ils ne cessent de produire des situations très révélatrices des mutations de notre société, surtout quand les nations se mettent en scène lors du grand rendez-vous mondial que j’ai qualifié ailleurs de « foire aux identités ».
Que l’on soit passionné(e) de football ou non, une Coupe du monde, avec toute la symbolique que les équipes véhiculent, c’est comme un impératif de mettre en avant son appartenance nationale. En fait, l’identité nationale standard qu’on nous réclame, c’est un peu comme les billets de la SNCF qui sont « non-échangeables, non-remboursables ». Et lors d’un événement comme la Coupe du monde, il faut « composter », en « vibrant » avec une équipe qui porte haut nos couleurs.
Sauf que dans une Europe où le nombre d’individus qui ont plusieurs racines, des double-appartenances, ne cesse d’augmenter, cela peut être un moment problématique.
Il ne s’agit pas de faire à la Coupe du monde le procès galvaudé de la « manipulation des masses », du « simulacre de guerre » ou encore du football « opium du peuple ». Au contraire : l’histoire nous a montré amplement que ce jeu ne se laisse pas facilement instrumentaliser à des fins politiques.
D’autant que les grandes euphories collectives un peu démesurées que le football déclenche – comme celle qu’on a vécue en France en 1998 – restent des sentiments très éphémères. Le nationalisme suscité par ces grands tournois festifs, est au fond assez « light ». Il répond à un besoin de se rassurer dans un collectif imaginé et de le célébrer, tout en affirmant le droit des autres de faire de même.
En revanche, c’est justement la recherche internationale sur le football qui nous a montré combien nous sommes aujourd’hui en Europe, pour qui l’identité nationale est devenue un casse-tête. Pour ceux qui vivent une double-appartenance, en raison de leur histoire familiale ou d’une migration récente, le football est parfois un véritable pont avec leur enfance ou leurs racines, mais il est aussi truffé de pièges. Y compris, et surtout, pour les joueurs. L’Allemagne, championne du monde en titre, dotée d’une équipe dont on a justement célébré ces dernières années le caractère multiculturel, est en train de nous fournir une bonne illustration.
 Deux de ses joueurs sélectionnés pour le Mondial, Mesut Özil et Ilkay Gündoğan, tous deux d’origine turque mais de nationalité allemande, ont fait preuve d’une bêtise sans nom – et je pèse mes mots – en se laissant photographier en mai, sous la pression de leur agent, avec le Président turc, Reccep Tayip Erdoğan, lors d’un rendez-vous à Londres. Qui plus est, Gündoğan a même dédicacé son maillot pour, je cite, « mon président », alors qu’il n’a même pas la double-nationalité turque ! Joli cadeau de campagne électorale pour un leader politique plus que discutable en matière de respect pour la démocratie et les droits civiques. Et qui ne manque guère d’occasion de traiter les Allemands de « Nazis ».
Deux de ses joueurs sélectionnés pour le Mondial, Mesut Özil et Ilkay Gündoğan, tous deux d’origine turque mais de nationalité allemande, ont fait preuve d’une bêtise sans nom – et je pèse mes mots – en se laissant photographier en mai, sous la pression de leur agent, avec le Président turc, Reccep Tayip Erdoğan, lors d’un rendez-vous à Londres. Qui plus est, Gündoğan a même dédicacé son maillot pour, je cite, « mon président », alors qu’il n’a même pas la double-nationalité turque ! Joli cadeau de campagne électorale pour un leader politique plus que discutable en matière de respect pour la démocratie et les droits civiques. Et qui ne manque guère d’occasion de traiter les Allemands de « Nazis ».
Evidemment, c’est devenu une affaire d’Etat. L’extrême-droite s’en est emparé, les médias s’en sont donnés à cœur joie, les réseaux sociaux ont chauffé – même la Chancelière a dû s’exprimer sur le sujet en revenant de son G7 au Canada ! Bien sûr, les uns demandent l’exclusion de ces « traîtres » de l’équipe nationale, d’autres les défendent en associant les critiques à du racisme refoulé qui se libère au premier prétexte. Tout cela a pris une dimension presque grotesque, mais telle est la place que prend aujourd’hui le football dans notre société.
Quelle leçon faut-il tirer de cette histoire ?
Pour les joueurs, d’abord, il est temps qu’ils comprennent qu’il ne suffit plus d’être un virtuose du ballon, il faut posséder un minimum de sensibilité pour l’impact politique que possède son métier. Qu’ils n’aient pas eu le réflexe, après des années de carrière sous les feux de la rampe, de sentir qu’il y avait un problème à prêter leur popularité à un personnage comme Erdoğan et de dire non à leurs agents, franchement, c’est nul.
Pour les commentateurs qui ont l’indignation facile, il serait utile de faire preuve d’un peu d’empathie pour le grand nombre d’individus qui sont, malgré eux, tiraillés entre plusieurs communautés nationales ou culturelles. Avec toutes les attentes et les pressions qui vont avec. Quand les sentiments nationaux sont chauffés à bloc en raison d’un événement comme la Coupe du monde, ce n’est pas si facile que cela à vivre.
Enfin, pour les citoyens que nous sommes, soucieux pour la plupart d’entre nous, d’un vivre-ensemble harmonieux, la bonne nouvelle est que le football, au-delà des polémiques ponctuelles, reste un vecteur d’intégration drôlement puissant, y compris au niveau des équipes nationales. Notre recherche a montré que les trois quarts des Français considèrent que, je cite, « les joueurs issus de l’immigration et qui sont sélectionnés pour l’équipe nationale font une contribution importante à l’intégration sociale dans les pays où ils jouent ». En Allemagne, ils sont même près de 80% à être de cet avis. Ce sont des chiffres étonnants, auxquels, en toute franchise, nous ne nous attendions pas. Rien que pour cela, il faut espérer que les performances, dans les semaines qui viennent, de nos deux amis insouciants soient susceptibles de rassurer tout le monde sur leur capacité de vivre leur identité culturelle plurielle tout en s’identifiant aux valeurs de la société qu’ils ont choisi de représenter. Pour ma part, je leur souhaite, en tout cas, que leur performance sur le terrain de football soit nettement meilleure que celle de Monsieur Erdoğan aux urnes.