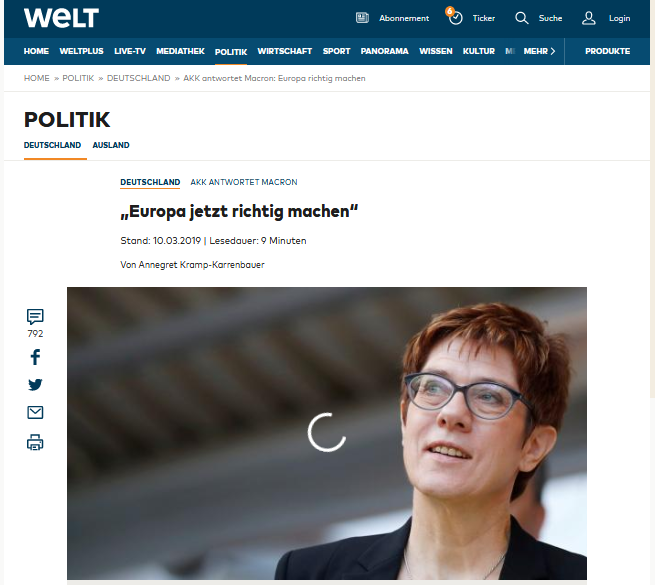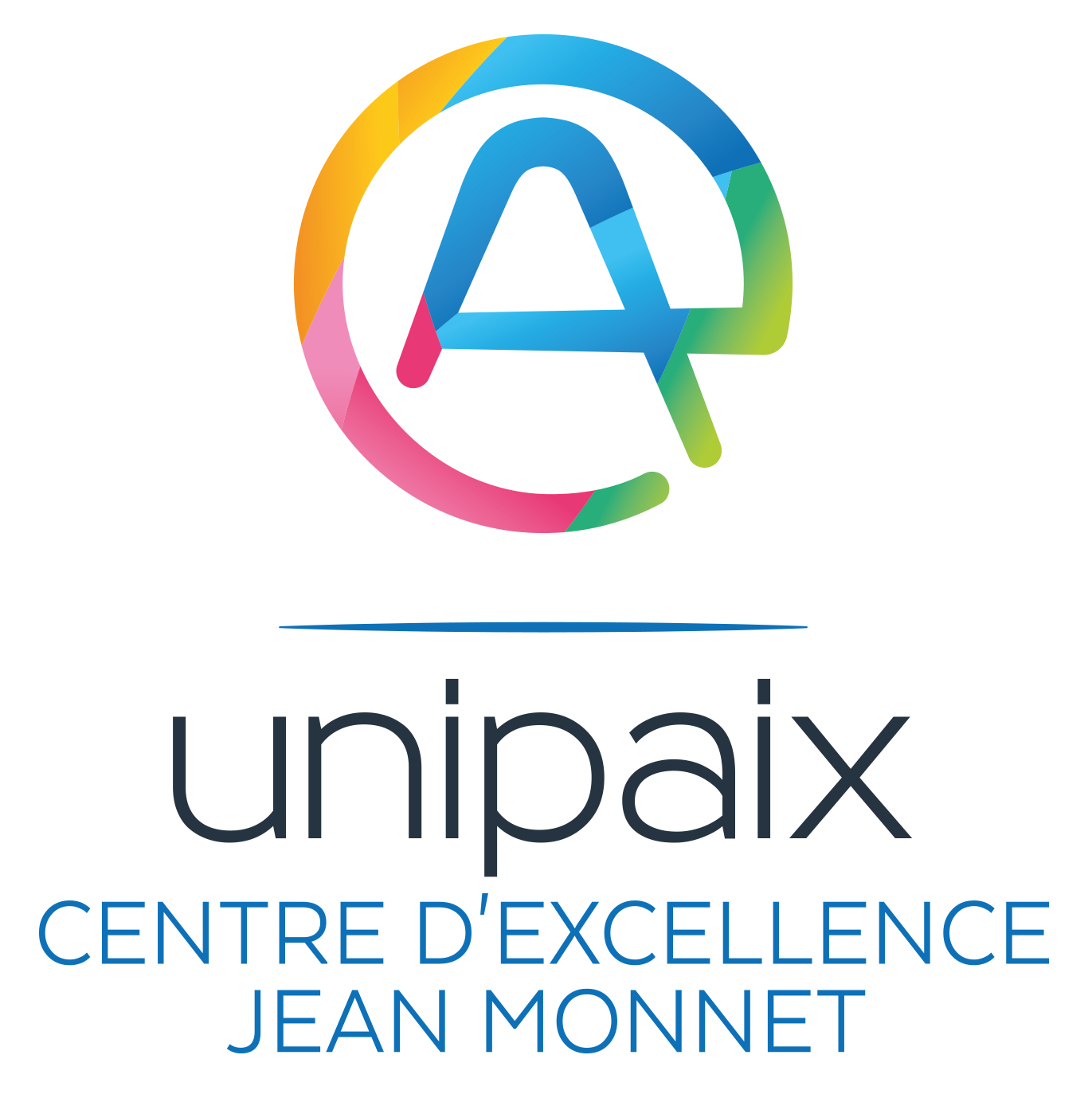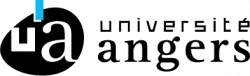Par Albrecht Sonntag
Rien ne se laisse mieux dramatiser qu’une chute, une déchéance, une disgrâce. Le favori qui perd la protection du prince, c’est un thème narratif universel de l’époque féodale, et il n’est pas surprenant qu’on le retrouve si souvent chez Shakespeare ou Schiller. La démocratie, privée des ressorts dramatiques de la Cour (quoique…) a inventé les « taux de popularité ». Les médias en raffolent : ces chiffres pseudo-objectifs qui illustrent la disgrâce du prince lui-même rappelle si délicieusement le mythe d’Icare : à force de s’approcher trop du soleil, on se brûle les ailes. C’est comme une revanche. Et subliminalement, cela nourrit ce sentiment doux-amer que le pays est sur une mauvaise pente, qu’il « va dans la mauvaise direction », comme aiment à formuler les sondeurs.
Les chiffres les plus discutés de l’été auront donc été les taux de popularité du président français élu à peine trois mois auparavant. Même la télévision chinoise s’en est émue, faisant de cette « descente aux enfers » la une d’un de ses magazines de politique étrangère à la mi-août. Héroïquement, les trois invités ont résisté à l’exhortation d’en faire une menace pour le nouvel exécutif français. Certes, le soutien ou l’approbation populaire contribue à la légitimité d’un chef de gouvernement, mais celle-ci se nourrit d’abord des urnes et de la majorité qui en est sortie. Non, la France n’est pas au bord de l’implosion.
Pourtant, il y a eu d’autres chiffres publiés cet été, autrement plus remarquables. Éclipses par la déchéance de Jupiter, ils sont passés à la trappe dans la plupart des médias. A commencer par ceux issus de l’enquête sur les « Fractures françaises » mesurées chaque année par IPSOS-Sopra Steria, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po. Sauf erreur de ma part, c’est bien la première fois depuis que le mot « mondialisation » a fait son entrée dans le vocabulaire des Français durant les années 90, qu’une majorité de citoyens (52%) y voient une opportunité plutôt qu’une menace. Il y a quatre ans seulement, on en était encore loin (39%, contre 61% respectivement). Idem pour l’appartenance de la France à l’Union européenne : il n’y a plus que 26% des citoyens à considérer que c’est « une mauvaise chose » (ceux qui estiment le contraire sont désormais 58%) – un niveau qui n’a pas été atteint depuis longtemps. Et l’Euro, lui, bénéficie désormais d’une cote de 80% d’adhésion.
On peut attribuer ces évolutions à l’effet dissuasif combiné du Brexit et de Trump et ses consorts. Mais dans la même enquêté, on trouve aussi que 71% des sondés estiment « dépassées » les notions de gauche et de droite : visiblement, l’effet de renouveau qu’a profondément marqué les élections législatives de juin a laissé des échos plus profonds dans la société que ne le laissent deviner les fameux taux de popularité.

D’autres chiffres de l’été confirment cette embellie toute relative. L’enquête « eupinions », régulièrement effectuée à travers l’Europe des 28 par la Fondation Bertelsmann avec le soutien de Dalia Research révèle ainsi que le nombre des Français qui ont l’impression que leur pays « va dans la bonne direction » a triplé en quelques mois. Si au début du printemps, il était à 12%, il est désormais (juillet 2017) à 36%. Dans le pays du pessimisme, c’est remarquable en soi, même s’il faut bien reconnaître qu’il y encore de la marge (notons que les Allemands sont 59% à avoir cette perception des choses). Le sondage corrobore en même temps le recul relatif de l’Euroscepticisme diagnostiqué par l’enquête française : s’il y avait un référendum comme au Royaume-Uni, 69% des Français voteraient pour un maintien de l’adhésion (contre 75% des Allemands) ; et quant au rôle dominant joué par l’Allemagne au sein de l’Union, 61% des Français s’en accommodent fort bien, le considérant comme « une bonne chose ». Téléchargement gratuit de l’enquête (en anglais) ici.
Des chiffres intéressants et révélateurs du fait que nous vivons une période où les choses bougent. Qui aurait pronostiqué de telles évolutions dans l’opinion publique il y a un an seulement ? Des chiffres qui auraient mérité davantage de place et d’attention dans les médias que les taux de popularité du président.

Ceci dit, sur les réseaux sociaux, même si le Macron-bashing a trouvé un terrain d’élection, le désamour pour le président a été relégué au deuxième plan. Là, très clairement, les chiffres de l’été qui ont vraiment fait le buzz, ce sont les indemnités de transfert du PSG : 222 000 000 Euros pour s’attacher les services de Neymar – même Jupiter est éclipsé par les Dieux du stade.