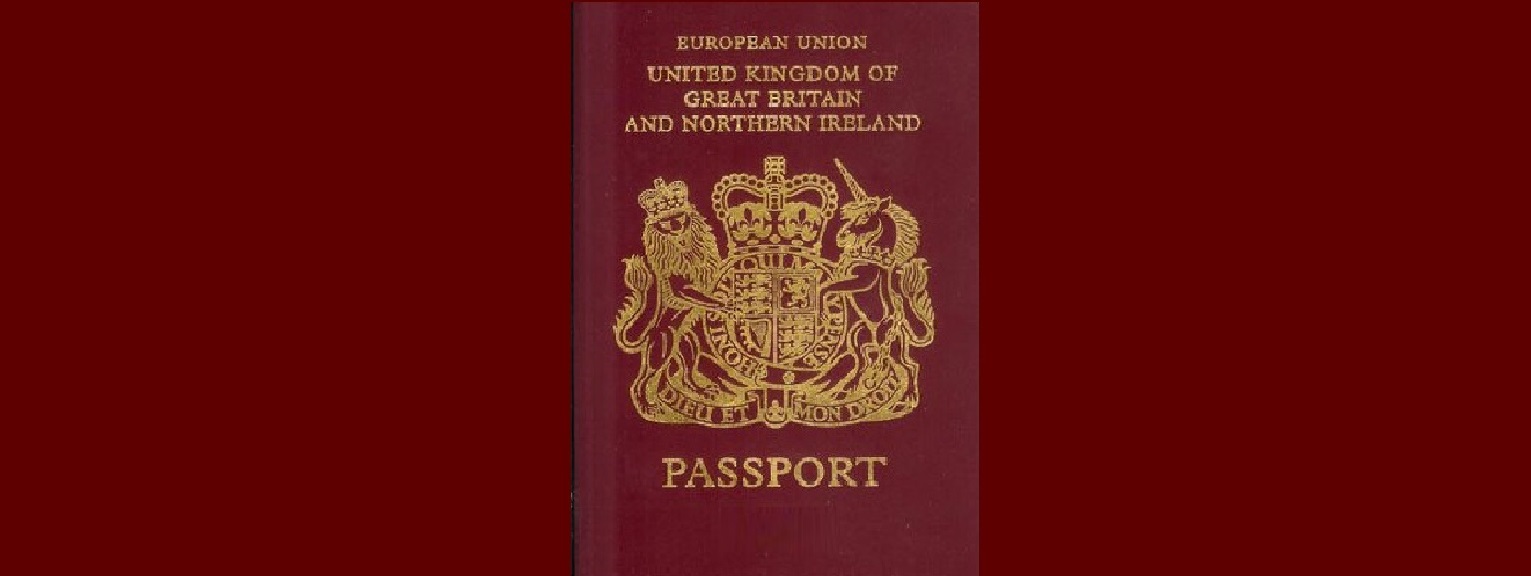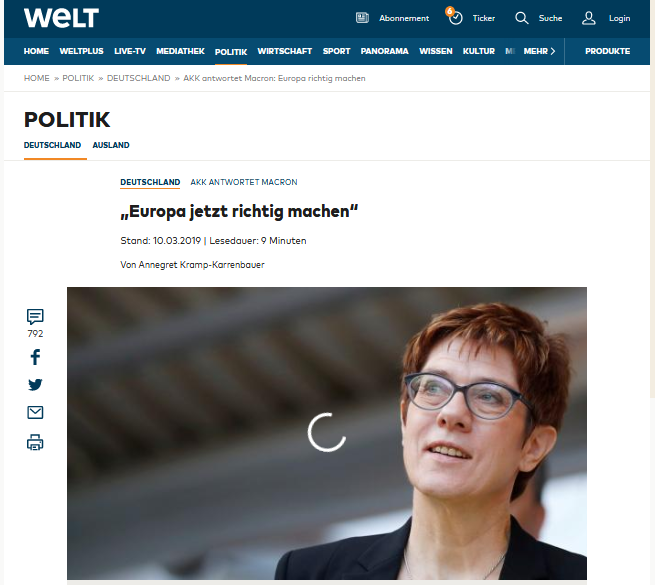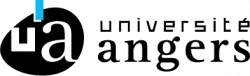Par Helen Drake
Si nous définissons une « crise » (comme l’ont fait récemment mes étudiants lors d’une discussion) comme une situation complexe et difficile, caractérisée par un conflit et de l’incertitude, et présentant des enjeux très élevés pour plusieurs acteurs, le Brexit semble effectivement en être une, à plusieurs égards.
Une crise politique
Il y a d’abord une véritable crise de l’autorité exécutive au Royaume-Uni. Rappelons que la Première ministre, Theresa May, a voté en faveur du maintien lors du référendum du 23 juin 2016. Mais elle a surfé vers le pouvoir sur la vague d’un tumulte au sein du parti conservateur, se laissant mandater de transformer le vote populaire en Brexit réel et tangible. Elle a ensuite nommé un genre de triumvirat de ministres chargés de formuler la stratégie du Brexit dont aucun n’a été particulièrement bien préparé pour occuper un tel poste (peu surprenant, étant donné le manque de préparation tout court).
La Première ministre n’a qu’une très courte majorité de 14 sièges dans l’Assemblée et fait face à une minorité bruyante d’Europhobes dans son parti. Sa préférence pour déclencher le fameux article 50, qui notifie les 27 autres Etats-membres officiellement de l’intention de son pays de quitter l’Union, reste la prérogative de la Reine (et donc, en fait, de l’exécutif). Comme on le sait, cette prérogative a été mise en question et fait actuellement l’objet d’une procédure légale.
Sa capacité même de dessiner une approche nationale du Royaume est mise à mal par des pressions politiques permanentes exercées par les administrations d’Irlande du Nord, d’Ecosse et du Pays de Galles. Et sa crédibilité en tant que chef de gouvernement au sein du Conseil Européen est d’ores et déjà minée par le fait que le vote britannique – et c’était parfaitement prévisible – donné naissance à une « Europe des 28 moins 1 » avant même que le Brexit ne se matérialise.
Une crise constitutionnelle ?
En plus de la crise de l’exécutif, faudrait-il parler d’une crise constitutionnelle ? Le Brexit est le résultat d’un vote populaire qui, s’il a été simplement « consultatif » juridiquement parlant, s’avère être, sur le plan politique, totalement contraignant pour la Première ministre. Le vote semble avoir fait naître un nouveau corps politique – « le Peuple » – encouragé par la campagne du « Leave » de « reprendre le contrôle ». Aujourd’hui, ce « Peuple » est de plus en plus désigné comme investi de la légitimité d’outrepasser son parlement représentatif et son « opinion » se voit désormais placée à égalité avec les règles de l’Etat de droit et les procédures établies.
Ce « peuple » est construit par les médias populaires comme s’il s’agissait de la totalité de l’électorat britannique, plutôt que l’échantillon qui s’est déplacé aux urnes et a voté pour le départ en juin dernier. Les procédures établies sont désormais traitées de « manières de ne pas avancer » dans le sens voulu par le « Peuple ». Tout cela représente des déviations déroutantes des normes constitutionnelles de la souveraineté parlementaire.
Peut-être moins surprenant, vu la trajectoire de la décentralisation des dernières années, est le défi que lance le vote référendaire à l’unité du Royaume. Le fait que l’Ecosse et l’Irlande-du-Nord aient « perdu » le vote (en s’exprimant pour le maintien à 62% et 56% respectivement), alors que le Pays-de-Galles se place du camp des « gagnants » avec l’Angleterre (avec 52.5% pour le départ), met le statu quo du Royaume en danger. En même temps, les trois administrations partagent leur inquiétude au sujet du Brexit. Ce dernier met en case leurs économies, leurs sociétés, leur pérennité en tant qu’entités autogouvernées, et même leurs identités en tant que nations au sein de deux unions.
Une crise de la politique démocratique
Les crises mises à jour par le Brexit s’inscrivent dans une crise plus large, celle de la démocratie. Durant des décennies, une presse nationale europhobe a eu les coudées franches pour semer la méfiance, voire la haine de l’Union européenne. Durant la campagne référendaire, elle a laissé tomber les derniers masques, propageant des mensonges outranciers sur l’Union européenne et tolérant la mise en scène d’un imaginaire ouvertement raciste par son franc-tireur préféré, Nigel Farage, désormais grand ami de Donald Trump. L’immigration, et sa jumelle hideuse, la xénophobie, ont fini par dominer entièrement le débat référendaire. Depuis, les sondages confirment que la maîtrise de l’immigration reste en haut des demandes populaires pour la négociation du Brexit.
Ce qui est inquiétant dans cette évolution n’est pas le sujet de l’immigration en soi. En revanche, sa construction discursive dans un langage non-démocratique et post-factuel, truffé de sentiments narcissiques et demi-vérités.
Une crise d’identité personnelle
Quand j’ai eu l’occasion de partager ses impressions en novembre devant un public intéressé à Nantes, j’ai commencé par brandir mon passeport. Ce petit document joliment illustré relie mon identité personnelle à la fois au « United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland » et à l’Union européenne. Il est valide jusqu’en 2026, mais une fois le Brexit consommé, serai-je obligée d’en demander un autre, sans mention de l’Europe ? Et à mes propres frais ? Me trouverai-je privée de certains droits qui m’ont semblé acquis, que j’en profite consciemment (la liberté de mouvement) ou inconsciemment (en tant que consommatrice, par exemple) ?
On dirait qu’au-delà d’une crise politique, d’une crise constitutionnelle et d’une crise de la démocratie, le Brexit finira même par être une d’identité personnelle qu’ayant passé la quarantaine depuis un moment, je n’attendais plus ?