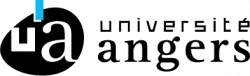Par Helen Drake
En tant qu’universitaire basée au Royaume-Uni et présidente de l’UACES, l’association académique internationale en études européennes, j’ai un bon aperçu de l’état de l’enseignement supérieur sur l’Europe contemporaine en général et sur l’Union européenne en particulier. Permettez-moi de l’illustrer avec l’exemple d’une institution située dans les Midlands, en plein cœur de l’Angleterre, l’Université de Loughborough.
Les « Études européennes » y ont fait leur apparition en tant que nouvelle discipline durant l’année 1968/69, lorsque la Faculté des Études Humaines et Environnementales se mit à proposer une nouvelle licence (« Bachelor of Science ») en « Institutions et langues de l’Europe moderne ». Ce nouveau diplôme était censé répondre à un nouveau besoin, celui d’un programme « qui combine les langues avec des connaissances en sciences sociales, notamment en économie et politique. (…) Le programme est professionnalisant, mais pas exclusivement, dans la mesure où il vise à former des diplômés qui possèdent des compétences en deux langues européennes, doublées d’une bonne connaissance de l’économie et des institutions économiques et politiques des pays majeurs du Marché Commun » (page 75 du catalogue de cours 1968/69).
On voyait donc un intérêt à proposer des études d’une communauté européenne dont le Royaume-Uni n’était même pas encore un membre, avant de la rejoindre cinq ans plus tard, en 1973.
Ce nouveau programme s’est vite développé pour devenir un diplôme « LPEME » (« Languages, Politics and Economics of Modern Europe »), et en 1972/73, un Département d’Études Européennes fut créé, en tant que département « multi-disciplinaire ». En 1975/76, le sigle « LPEME » fut remplacé par « MES » (« Modern European Studies »), diplôme pour lequel les étudiants n’avaient plus à étudier deux langues étrangères plus la politique plus l’économique, mais pouvaient faire un choix (même si une langue étrangère restait obligatoire). Les étudiants choisissant l’option politique avaient un cours obligatoire en « Politique de l’intégration européenne » dans leur dernière année, et ils pouvaient y ajouter un cours en « Droit public et institutions de la Communauté économique européenne ».
Durant les décennies suivantes, ces cours disparaissaient. Puis, en 2010, le programme en « Modern European Studies » lui-même fut rayé de la liste des diplômes, tandis que l’expression « études européennes » fut supprimé du nom du département. Les étudiants n’avaient plus accès à un programme diplômant combinant les langues étrangères et les sciences sociales aussi rigoureusement que cela avait été le cas en 1968. Certes, le département préserva son expertise académique en études européennes jusque dans les années 2000, obtenant même des financements Jean Monnet de la part de la Commission européenne censés soutenir l’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne, alors que les « études européennes » ne représentaient plus qu’une poignée de cours dont aucun n’était obligatoire pour aucun étudiant. En 2015, enfin, la Bibliothèque Universitaire finit par emballer son Centre de Documentation Européenne qui avait servi de dépôt de documentation officielle de l’Union européenne pour toute la région.
Cette histoire de la naissance et du déclin des études européennes à Loughborough est parfaitement représentative de la situation en 2016/17 : les études européennes, à quelques exceptions près, ont disparu des curricula des universités britanniques, les départements ont été fermés, et la discipline ne méritait même plus sa propre « sous-commission » dans la dernière grande évaluation nationale de la recherche en 2014, le « Research Excellence Framework » (REF) qui dresse le classement (en vue de leur financement futur) de la recherche dans les universités du Royaume. Ce fut une rupture avec les évaluations précédentes (en 2008, 2001, 1996 et 1992 respectivement), lors desquelles les études européennes avaient encore été considérées comme une discipline à part entière.

C’est là une rupture significative, qui en cache une autre. Comme l’a fait remarquer mon collègue Michael Smith en 2008 déjà, il y avait eu « un glissement des études axées sur les langues vers des études concentrées sur les sciences humaines et sociales dans lesquelles la langue de recherche et de publication est très majoritairement l’anglais ». Il a ainsi rejoint Kenneth Dyson, le président de la commission d’évaluation des Etudes Européennes en 2001, qui, dans son rapport, avait alerté de façon prémonitoire que « dans l’absence d’un plan d’action urgent et large en soutien de la discipline, les fondations de la recherche en Études Européennes s’effriteront rapidement, et la Grande-Bretagne perdra les ressources de connaissances en langue étrangères et de compétences culturelles nécessaires pour jouer avec succès son rôle en Europe ».
En fait, dès 1975, le grand historien Alan Milward, avait anticipé dans un article du Journal of Common Market Studies, que « la justification ultime des Études Européennes » devait être « d’ordre intellectuel » : « en fin de compte, le développement futur des Études Européennes dépend du lien qu’elles établissent entre le mouvement d’une association plus étroite des nations européennes avec les aspects plus larges de la civilisation européenne, non pas sous forme de platitudes, mais dans une approche académique critique. La seule étude de l’évolution de la Communauté ne saurait suffire pour ce faire, même si sans elle, il n’y a pas de fondement sur lequel construire. » (voir ‘The European Studies Movement: What’s in a Name?’, JCMS, Vol. XIV, No. 1, page 80.)
Il suffit de scruter le programme des dernières grandes conférences annuelles de l’UACES, à Londres en 2016 ou à Cracovie en 2017, pour constater un rétrécissement de l’étude de « l’Europe » dans l’enseignement supérieur vers l’étude presque exclusive de « l’Union Européenne » (ce qui est, bien entendu, en lui-même, un champ vaste et varié). Il en est de même quand on regarde les thématiques de thèse de doctorat qu’explorent les boursiers actuels de l’UACES.
Tous ces chercheurs ne sont pas basés au Royaume-Uni – loin s’en faut ! – mais beaucoup d’entre eux le sont, et leurs observations se recoupent : leurs étudiants qui sont passés par l’enseignement britannique arrivent à l’université avec un véritable déficit de connaissance sur l’Union Européenne et ses États-membres, surtout en comparaison avec leurs camarades ERASMUS venus d’autres pays européens. Ce n’est guère une surprise : non seulement l’enseignement sur l’Europe ou l’UE est quasi-inexistant dans les programmes scolaires, mais l’apprentissage des langues étrangères est fortement en déclin dans l’enseignement public depuis plus d’une décennie.
Faut-il alors s’étonner que lors du référendum de juin 2016, le vote pour ou contre le Brexit ait été fortement corrélé au niveau d’éducation ? En effet, les catégories d’un niveau plus élevé étaient plus susceptibles de voter en faveur du maintien. Bien entendu, mon argument n’est pas que les jeunes Britanniques devraient être mieux éduqués sur l’Europe afin de soutenir l’Union européenne. Mais ils méritent certainement une meilleure éducation sur la citoyenneté dans toutes ses dimensions.

L’une des citations les plus connues de l’écrivain Rudyard Kipling (1865-1936) est la phrase « Que peuvent savoir de l’Angleterre ceux qui ne connaissant que l’Angleterre ? » Elle n’a jamais été autant d’actualité. Que peut-on savoir de son propre pays et de sa place dans le monde, si on n’apprend que si peu sur ses voisins et les langues qu’ils parlent ?