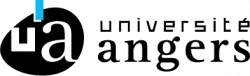Propos recueillis par Cédric Enjalbert (25 juin 2016)
Propos recueillis par Cédric Enjalbert (25 juin 2016)Quelle a été votre réaction en apprenant le résultat du référendum britannique sur la sortie de l’Union européenne ?
Jean-Marc Ferry : Spontanément, j’ai pensé d’abord aux conséquences pour le Royaume-Uni lui-même. Les Anglais – je ne dis pas les Britanniques – sont souverainistes par rapport à l’Union européenne. Mais les Écossais sont souverainistes par rapport aux Anglais. Ils veulent rester dans l’Union. Cela peut avoir un effet d’entraînement sur les Irlandais du Nord. Il existe un risque de dislocation du Royaume-Uni, qui est bien plus grave que la dévaluation de la livre sterling, qui pourrait se retrouver en dessous du niveau de l’euro.
Du point de vue de l’Union européenne, ce n’est pas seulement un problème économique et financier. Au delà des idées comptables, c’est l’unité politique qui est en jeu. Si tout se passe bien, la relation du Royaume-Uni à l’Union européenne se rapprochera de celle de la Suisse ou de la Norvège, fondée sur un système d’accords bilatéraux. Cependant, je crains que les Britanniques n’aient pas beaucoup à y gagner parce qu’au fond ils devront accepter de devoir signer ou refuser les acquis communautaires, sans pouvoir participer à leur élaboration. Les Anglais pensent gagner de la souveraineté, mais ils en ont peut-être perdu.
Doit-on regretter la sortie du Royaume-Uni de l’Europe ?
La tendance spontanée du Royaume-Uni était l’élargissement indéfini d’un grand marché sur un modèle de libre échange, alors qu’au départ l’Europe était une union douanière. Ce n’est pas la même chose ! D’une certaine façon, les Anglais l’ont emporté. Ils représentent une option qui n’est pas initialement celle de l’Union européenne, mais surtout ils entretiennent depuis leur adhésion un rapport utilitariste à l’égard de l’Union européenne : par un calcul avantage-coût, on compare ce que l’on retire de l’association à ce qu’on lui apporte. On se souvient de la phrase de Margaret Thatcher : « I want my money back » [«je veux mon argent»]. L’Angleterre n’a pas investi l’Union européenne politiquement mais économiquement avant tout. Il y a eu un effet de contagion en Europe centrale. Pour parler trivialement, l’Union est traitée comme une vache à lait, sans que l’on fasse preuve de la réciprocité nécessaire à une union politique. Cette vision utilitariste ne peut qu’avoir des effets délétères.
Maintenant, bien que le Royaume-Uni a bloqué systématiquement les grands investissements nécessaires à l’équilibre européen, le Brexit reste un immense dommage pour l’Union européenne. Avec le retrait du Royaume Uni, l’Union perd un exemple de démocratie parlementaire et de libéralisme politique. Or ce modèle est précieux pour l’équilibre « spirituel » de l’Europe.
« Avec le retrait du Royaume-Uni, l’Union perd un exemple de démocratie parlementaire et de libéralisme politique. Ce modèle est précieux pour l’équilibre “spirituel“ de l’Europe »
Quelles en seront les conséquences pour l’Union européenne ?
Une négociation longue va s’engager. Ce ne doit pas être l’occasion de retarder des réformes structurelles profondes, rendues nécessaires par les nombreux déséquilibres dont souffre l’Union. Derrière les mauvaises raisons du Brexit, il existe des raisons de fond qu’il convient de considérer sans stigmatiser les réclamations sous l’anathème souverainiste ou populiste. La réclamation en faveur d’une autonomie civique est juste, voire, salutaire : que les citoyens veuillent se sentir les auteurs des normes dont ils sont les destinataires est essentiel. Les Britanniques refusent l’idée que la gouvernance européenne se stabilise au-dessus de leur tête comme un processus irréversible auquel ils ne participeraient pas.
Maintenant, il est paradoxal que les Anglais aient finalement moins de raisons que d’autres – les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Français… – de dénoncer un court-circuitage des procédures parlementaires, le diktat des marchés sur leur budget national, la confiscation de leur politique monétaire et budgétaire. En effet, ils ne sont ni dans la zone euro ni dans l’espace Schengen. Cependant, ils se sentent victimes d’un processus post-démocratique. Ce paradoxe du Brexit doit faire réfléchir.
Pourquoi parler de « post-démocratie » ?
Trop de déséquilibres rendent le fonctionnement de l’Union européenne inacceptable. Je pense, entre autres, au déséquilibre entre un gouvernement par les règles et un gouvernement par le consentement des peuples, mais aussi entre la protection juridique des individus et la participation politique des peuples, ou encore entre le public et le privé. Le processus européen peut être lu en effet comme une entreprise de privatisation de la politique, car son organisation n’a que très peu de caractère public. Au fond, en quoi consiste-t-elle ? En des tractations entre des groupes d’intérêt qui se grappent autour de la rue de la Loi, à Bruxelles, où siège la Commission. Cet aspect techno-bureaucratique est semi-privé. Ensuite, les accords intergouvernementaux sont agencés sur la voie de négociations diplomatiques discrètes et, plus discrets encore, le règlement des éventuels contentieux et différends entre les États membres. Les compromis réalisés suivent des voies qui n’ont rien d’une délibération démocratique et publique. Il est temps de changer le style ; de mettre en arène publique des enjeux et des problèmes de l’Union. Les dirigeants en Europe, qui sont les dirigeants des État membres, prennent les décisions en huis clos avant de se charger mutuellement de « gérer » chacun chez soi « son » opinion publique pour faire accepter les mesures adoptées. Il en résulte un court-circuitage des procédures démocratiques, qui est mal accepté par beaucoup, notamment par les Anglais dont la culture politique est marquée par la souveraineté parlementaire.
Comment réformer ce fonctionnement qui va à l’encontre des exigences démocratiques ?
La priorité : réformer le style. La démocratie, qu’elle soit représentative, participative ou délibérative, est à peu près invisible au plan européen. L’Union européenne repose sur une démocratie simplement acclamative qui, de plus, fonctionne mal, sous l’argument trop simple qu’il faut aller de l’avant. Ce discours n’est plus d’actualité. Les peuples doivent être associés aux décisions politiques européennes. Encore une fois, un style nouveau, mieux centré sur des discussions ouvertes, doit prendre le pas sur les tractations discrètes. Sur cette base, on peut alors engager d’importantes réformes institutionnelles.
Par exemple : la méthode communautaire a été injustement abandonnée avec le tournant du Traité de Maastricht. Je pense qu’il faudrait plutôt approfondir cette méthode en asseyant la légitimité d’un président de l’Union — et d’un seul ! — qui devrait être normalement président de la commission, la seule instance à vocation gouvernementale, car, d’un point de vue constitutionnel, c’est la seule dont la responsabilité politique puisse être engagée. Un tel pouvoir gouvernemental doit jouir d’une autorité politique forte et, pour cela, d’une légitimité qui pourrait procéder de l’ensemble des parlements nationaux associés, en liaison avec le Parlement européen. Autorité n’est pas souveraineté. Les États membres restent souverains. Une méthode communautaire révisée, approfondie démocratiquement, proposerait d’organiser de façon horizontale une co-souveraineté bien ordonnée. Il s’agit d’une concertation et non d’une subordination. La vocation de l’Europe politique n’est pas celle d’un État fédéral supranational. L’Union européenne n’est pas une république fédérale inachevée. L’image des « États-Unis d’Europe » est trompeuse. Le modèle de l’État fédéral ne convient pas pour penser l’Europe. En appelant à « franchir le Rubicon fédéral », les européistes rendent un mauvais service à la cause européenne, presque aussi préjudiciable que les souverainistes. Les gouvernants ne peuvent plus se contenter de dire : « il faut plus d’Europe », etc. Permettez moi une métaphore un peu insolite : dans l’aviation de plaisance, quand on « décroche », au lieu de tirer la commande pour aller vers le haut, il convient au contraire de la rabattre pour redescendre et reprendre de l’assise. L’image est valable pour la relance de l’Union : reprendre le contact avec les peuples. Comment ? En prenant au sérieux le bien-fondé de ce fond de résistance démocratique qui s’oppose au processus européen et en mettant en arène les contestations et les différends, plutôt qu’en les occultant. Les citoyens ne sont pas des enfants. Ils veulent être pris au sérieux et se sentir partie prenante du projet européen. Faute de quoi le projet lui-même s’expose à une récusation massive.
Les analystes, en Angleterre notamment, soulignent que le choix du Brexit est l’aboutissement d’un jeu électoral mené par Cameron, manipulé par des discours populistes, qui a finalement mal tourné. On peut aussi penser que les citoyens britanniques savent très bien pour quoi ils ont voté…
Ce n’est pas « ou bien ou bien ». Les deux hypothèses sont vraies. Que David Cameron ait eu des soucis de gestion de son propre parti conservateur et que, pour cette raison, il ait pris la responsabilité, ou plutôt l’irresponsabilité, de proposer ce référendum, cela n’empêche pas que, contrairement à ce qui s’est passé en France en 2005, par exemple, lors du référendum sur le Traité constitutionnel, les Anglais ne se soient pas trompés d’enjeu. Ils n’ont pas voté sur une question nationale mais bien pour un enjeu européen. La question n’était pas faussée ou déplacée. Les Anglais se sont prononcés contre leur appartenance à l’Union et non contre le gouvernement conservateur. Il est inopérant de prendre la question par le petit bout de la lorgnette en ne s’attardant qu’à la dimension stratégique et électoralement mesquine du Brexit. Il importe de comprendre le choix du peuple anglais.
« L’identité européenne, si l’on en croit des philosophes, consiste essentiellement à s’ouvrir aux autres identités »
Que doit-on redouter à l’avenir ?
Il est difficile d’élaborer des scénarios prospectifs. Le risque serait de constituer une Europe à plusieurs vitesses, fait d’un noyau très restreint, regroupant les premiers membres de la construction européenne. Il en serait fini de l’ouverture à la Méditerranée, à ses rives méridionales et orientales. Le repli sur ce noyau restreint, portant avec lui les incantations douteuses à une origine « carolingienne » de l’Europe, est un danger, car il repose sur une conception erronée de l’identité européenne. L’identité européenne, si l’on en croit des philosophes, consiste essentiellement à s’ouvrir aux autres identités. Il s’agit non pas de gérer un patrimoine civilisationnel, qui d’ailleurs nous vient à l’origine de l’extérieur, qu’il s’agisse d’Athènes ou de Jérusalem, mais de développer une identité relationnelle, communicationnelle.
Le Front national, en France, risque de faire du Brexit ses choux gras…
L’occasion est trop belle pour le Front national ! D’autant que ses membres pourront aisément contourner l’objection qui consisterait à dire : le Royaume-Uni n’appartient ni à la zone euro ni à l’espace Schengen que vous fustigez, vous êtes donc à coté de la question. Ils auront beau jeu de dire : voyez, les Anglais qui ne sont même pas dans la zone euro ni dans l’espace Schengen ont choisi de sortir de l’Europe. Alors nous, en France, a fortiori… Contre ce discours, la seule parade possible, autant que je puisse voir, est de prendre au sérieux les déclarations dites « eurosceptiques », qu’elles viennent de la gauche de la gauche ou de la droite de la droite, renvoyées paresseusement à une forme de populisme, de crypto-fascisme ou de souverainisme. Il existe dans ces contestations une matière politique à discuter et des enjeux démocratiques à défendre. Sans la culture pluraliste d’une identité européenne formée à la discussion ouverte, à la confrontation publique et non moins civile, tout projet politique commun est condamné.
Copyright Photo : Claude TRUONG-NGOC / Wikimedia Commons
Source : Philomag