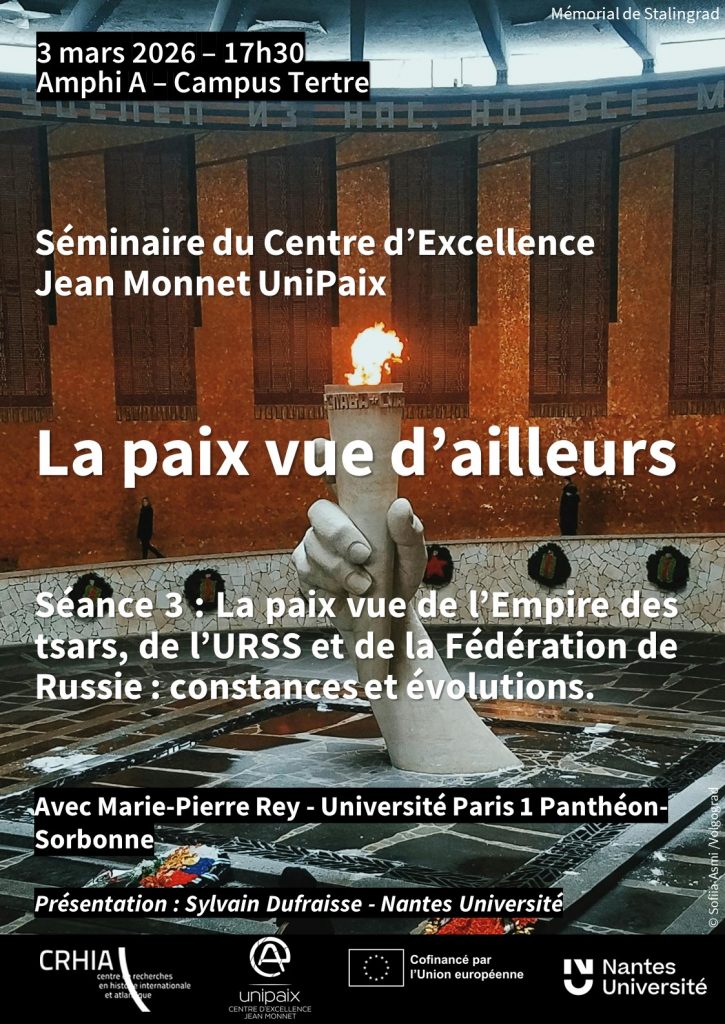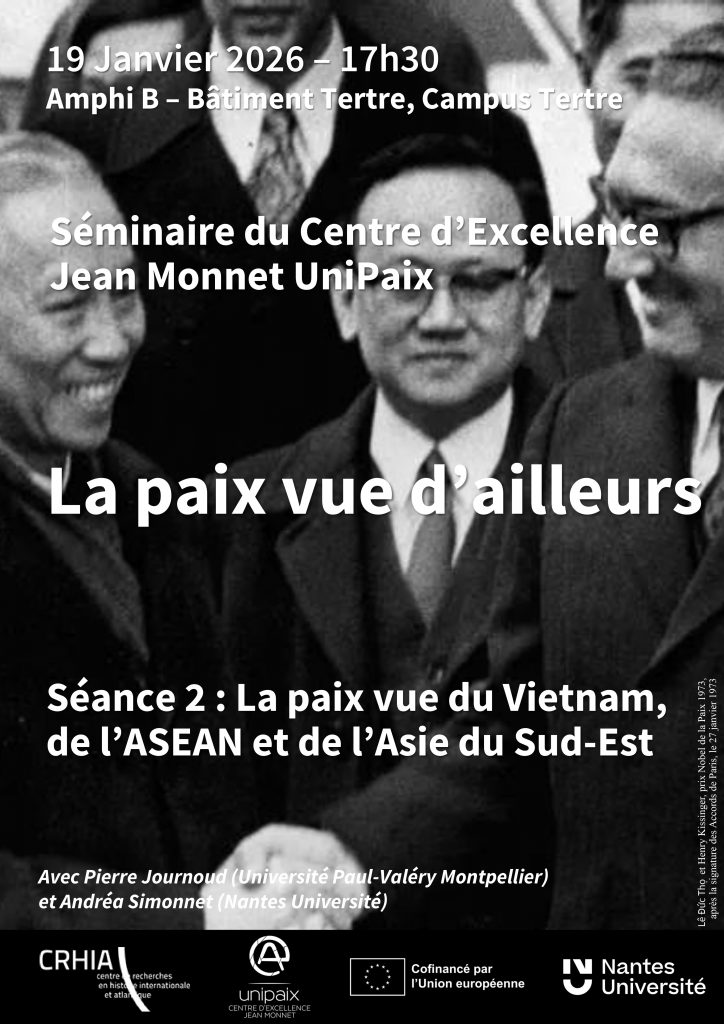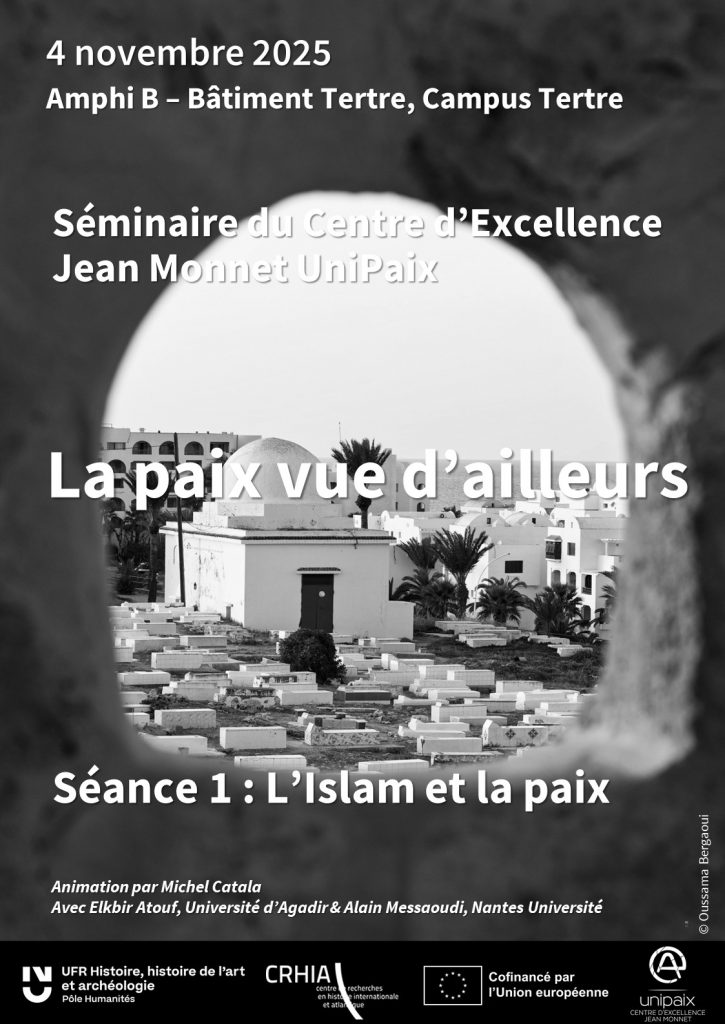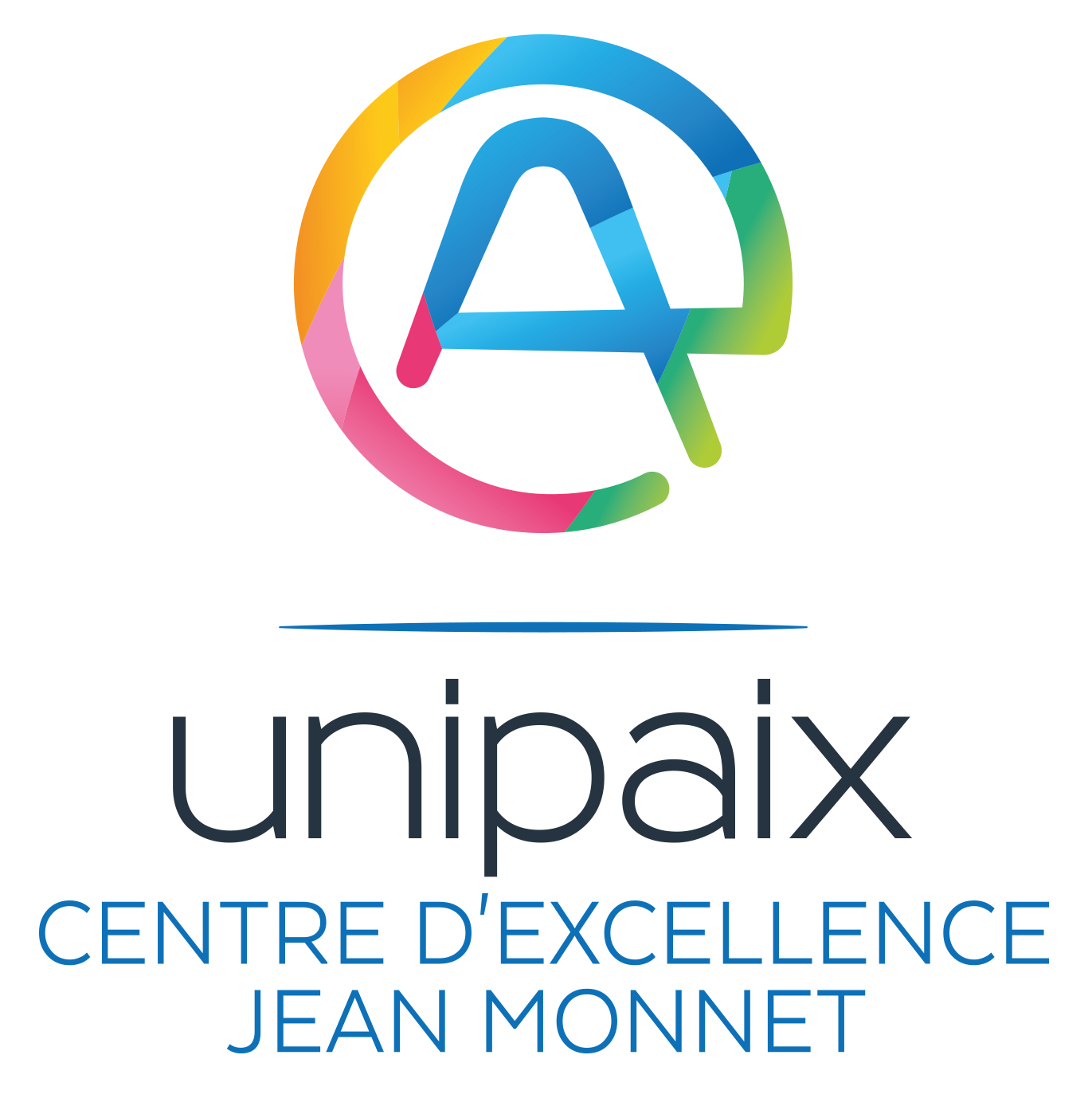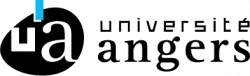La dernière journée d’étude Centre Jean Monnet – UniPaix s’est déroulée le 23 septembre dernier, organisée par/en collaboration avec le laboratoire DCS (Droit et Changement Social) de Nantes Université. Elle était intitulée : L’État de droit dans l’Union européenne – Un instrument de pérennisation de la paix ?
Elle a été organisée par Carole Billet, Co-directrice du CEJM et Maître de conférences en Droit public, Lauren Blatière, Professeure de Droit public à Nantes Université, Tristan Storme, Maître de conférences en Sciences Politiques à Nantes Université et Arnauld Leclerc, Professeur de Sciences Politiques à Nantes Université, tous membres du laboratoire Droit et Changement Social (DCS).

Cette riche journée s’est divisée en deux temps :
La matinée s’est concentrée sur La formation du concept de l’État de droit en Europe, à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes. Les échanges ont été suivis par une centaine d’étudiant.e.s.
Lors de l’après-midi, qui a eu lieu à la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, les intervenants se sont intéressés à La mobilisation de l’État de droit par l’Union européenne, réunissant un public d’une vingtaine de personnes.

Les échanges ayant eu lieu le 23 septembre ne s’arrêtent pas là. Un livret interactif de la Journée d’études sera prochainement publié, permettant de se replonger dans ces riches discussions.
Vous trouverez ci-dessous les résumés des communications de chacun et chacune, qui seront actualisés au fur et à mesure, ainsi que des extraits vidéos de la journée d’études.
La formation du concept de l’État de droit en Europe
- Généalogie allemande du concept d’État de droit
Olivier Jouanjan, Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas. M. Jouanjan n’a pas pu être présent lors de cette journée, mais participera à la publication des actes de la journée d’étude.
- La redéfinition de l’État de droit dans l’ère post-Nuremberg
Valéry Pratt, Professeur de chaire supérieure en philosophie à Amiens.

Découvrez un extrait de sa communication :
- L’européanisation du concept d’État de droit et ses limites
Arnaud Leclerc, Professeur de Sciences Politiques à Nantes Université.

Découvrez un extrait de sa communication :
- Le Conseil de l’Europe et l’État de droit
Colombine Madelaine, Maîtresse de conférences à l’Université de Tours.

Résumé :
L’État de droit occupe désormais une place centrale dans l’activité du Conseil de l’Europe. Le terme est toutefois absent de ses textes fondateurs qui mentionnent la prééminence du droit dans la version française et la « rule of law » dans la version anglaise. Au tournant des années 1990, avec la fin de la guerre froide et dans un contexte où cette organisation internationale connait un renouveau avec l’adhésion massive des pays d’Europe centrale et orientale et de la Russie, la notion d’État de droit fait son apparition dans son activité normative. En particulier, la création, au sein du Conseil de l’Europe, de la Commission de Venise et de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice vont beaucoup œuvrer à la diffusion de cette notion, non seulement au sein de l’organisation, et en particulier de la jurisprudence de la Cour EDH, mais également des États membres. A la même période, avec la création de l’UE, cette notion fait aussi son entrée dans le droit primaire avec le Traité de Maastricht. Devenue omniprésente à partir des années 2010, et bien que manquant de cohérence, elle a acquis une performativité croissante, notamment grâce à une application synchronisée avec les organes de l’UE.
Découvrez un extrait de sa communication :
- État de droit et sécurité juridique dans l’Union européenne
Élise Bernard, Docteur en droit public.

Résumé :
La paix ne se maintient pas par la force, mais par la compréhension, la confiance et la sécurité juridique, piliers de l’État de droit dans l’Union européenne. Les ruptures de la paix — qu’elles soient internes ou internationales — illustrent les dangers de l’arbitraire, de l’instabilité législative et du mépris des institutions. Les penseurs ont théorisé ce lien entre sécurité juridique et paix, tandis que des arrêts emblématiques de la CJUE le mettent en œuvre. Ainsi, la résistance des représentants de la puissance publique, la désinformation, le populisme et les ingérences extérieures, en sapant la confiance dans les institutions et les juridictions, détruisent la confiance mutuelle et exacerbe les divisions. Sans cette confiance, la sécurité juridique et l’État de droit — fondements de la paix européenne — sont en péril. Les exigences tenant à l’adhésion de nouveaux Etats à l’UE ne sont pas suffisantes et être “simplement” Etat membre ne prémunit pas des régressions autocratiques. Face à ces défis, le temps est venu de renforcer nos instruments : mécanismes de sanction dissuasifs, éducation européenne contre la désinformation, ou recours citoyens élargis devant la CJUE. Sans ces avancées, nous risquons de perdre ce qui fait la force de l’Europe — un espace où le droit protège la paix, et où la confiance l’emporte sur la division.
Découvrez un extrait de sa communication :
La mobilisation de l’État de droit par l’Union européenne
- Juge de l’Union européenne et État de droit
Ornella Porchia, Juge au Tribunal de l’Union européenne.

Découvrez un extrait de sa communication :
- L’instrumentalisation de la protection des intérêts financiers au service de l’État de droit
Loïc Levoyer, Professeur à l’Université de Poitiers.

Résumé :
Les violations des principes de l’État de droit par les États membres de l’Union européenne sont susceptibles de compromettre la légalité financière ainsi que le principe de bonne gestion financière du budget européen. Face à des évolutions politiques préoccupantes dans certains États membres, la protection du budget européen envisagé originellement sous l’angle uniquement technique a pris une dimension politique : plusieurs mécanismes de financement européen ont été instrumentalisés au service de la garantie de l’Etat de droit. Parmi ces instruments financiers, certains sont spécialement dédiés à cet objet. Ils participent de l’instrumentalisation formelle. D’autres instruments sont opportunément utilisés dans cette perspective, sans y être spécialement dédiés. Ils constituent une instrumentalisation informelle. L’ensemble de ces instruments témoignent de la préoccupation des institutions de l’Union européenne de préserver les droits fondamentaux et l’État de droit face aux dérives illibérales.
Découvrez un extrait de sa communication :
- Les interactions entre l’Espace de liberté, de sécurité et de justice et l’État de droit
Carole Billet, Maîtresse de conférences en droit public à Nantes Université.

Résumé :
Le respect de l’État de droit est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment au regard des exigences du de l’indépendance des tribunaux, du droit à un recours juridictionnel effectif ou du respect des droits fondamentaux qui sont des éléments indispensables pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière migratoire ou de coopération policière et judiciaire. Toutefois, de façon surprenante, cette valeur de l’Union européenne apparaît encore insuffisamment prise en compte et protégée dans la construction de cet ensemble normatif. Cette étude vient ici souligner l’intégration limitée de l’État de droit dans la formation du droit de l’ELSJ, mais également la fragilisation de ce droit lors de sa mise en œuvre dans un contexte de crise de l’État de droit.
Découvrez un extrait de sa communication :
- La protection de l’État de droit dans la politique d’élargissement de l’Union européenne
Lauren Blatière, Professeure de droit public à Nantes Université.

Résumé :
La protection de l’État de droit dans le processus d’élargissement de l’Union européenne connait une montée en puissance incontestable, principalement à compter des années 2000 et de l’adhésion imminente d’un grand nombre d’États d’Europe de l’Est. L’Union européenne fournit depuis lors des efforts incontestables, tendant à placer l’État de droit au cœur, non seulement, des négociations d’adhésion, mais également – et plus largement – de l’ensemble du processus d’élargissement. Par exemple, la Commission européenne conditionne aujourd’hui l’obtention du statut d’État candidat au respect de l’État de droit, alors que les instruments financiers de pré-adhésion sont conditionnés par le respect de ce dernier. Malgré ce, les résultats obtenus demeurent incertains. Outre que le bilan des dernières adhésions et des adhésions en cours est contrasté dès lors que la protection de l’État de droit semble parfois céder devant d’autres priorités politiques, les résultats positifs obtenus sont par nature fragiles. D’une part, l’État de droit n’est pas un acquis définitif, de telle sorte que la vigilance doit demeurer constante. D’autre part, la protection de l’État de droit, particulièrement dans des États qui ne se sont pas construits autour de cette notion, demande un temps long. Cela suppose peut-être de repenser le paradigme de l’adhésion qui a toujours été pensée comme devant se réaliser le plus rapidement possible, notamment afin de conserver la motivation des États candidats.
- L’État de droit et l’accord sur l’Espace économique européen
Émilie Delcher, Maîtresse de conférences en droit public à Nantes Université.

Résumé :
L’espace économique européen (EEE) a été créé pour permettre à des États voisins de l’UE de participer au marché intérieur en 1992, avant que les valeurs de l’Union européenne ne soient consacrées à l’article 2 du TUE. L’Accord EEE ne comprend ainsi aucune référence à de quelconques « valeurs de l’EEE » ni a fortiori à l’« état de droit ». Cela ne suffit pourtant pas à exclure l’intérêt de la question de l’état de droit dans l’Espace économique européen. L’EEE est lui-même fondé sur le droit : il prévoit des mécanismes juridiques – orientés vers un objectif d’homogénéité juridique – garantissant l’application des normes du marché intérieur aux États de l’AELE pour lesquels une Cour spécifique a été créée : la Cour AELE. En se fondant sur les méthodes développées par la Cour de Justice, cette Cour a renforcé son propre office et par ce biais le primat du droit. Toutefois, si l’homogénéité peut ainsi être considérée comme un outil de garantie pour la prééminence du droit, elle pourrait à l’inverse conduire à une certaine dégradation de l’ état de droit, en contraignant les juges de la Cour AELE à un strict suivisme de la Cour de Justice et ainsi saper leur indépendance. Elle pourrait au contraire être utilisée de manière si extensive – justifiant l’intégration de normes ou leur interprétation maximaliste – qu’elle conduirait à pallier les divergences de bases juridiques entre l’UE et l’EEE au-delà de ce qui était prévisible au moment de la conclusion de l’accord d’une façon peu compatible avec les principes démocratiques.
Découvrez un extrait de sa communication :
- La contribution de l’Union européenne à la diffusion de l’État de droit dans le monde
Jean-Félix Delile, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Lorraine.

Résumé :
Selon l’article 21 du TUE, l’action de l’Union sur la scène internationale vise à promouvoir l’État de droit dans le reste du monde. La présente étude tend à vérifier si cet énoncé constitutionnel se vérifie en pratique. En premier lieu, un effort de l’Union pour projeter l’État de droit dans les États tiers a été constaté. Une clause de conditionnalité « État de droit » a ainsi été introduite dans de nombreux accords externes de l’Union. Cela étant, la géométrie de l’inclusion de cette clause est variable : elle est par exemple présente dans les accords de nouvelle génération conclus avec des États américains, mais absente de ceux liant l’Union à des États asiatiques. Cette géométrie variable se retrouve dans les instruments de coopération au développement : la promotion de l’État de droit est un objectif des programmes concernant les États africains, tandis que cet objectif ne figure pas dans les programmes asiatiques. En second lieu, une tension entre les sphères politique et judiciaire est perceptible au sujet de la promotion de l’État de droit dans l’ordre juridique international. La Commission et le Conseil ont en effet œuvré pour juridictionnaliser le contentieux de l’investissement et conservent l’ambition d’établir un tribunal multilatéral d’investissement. Mais, au cours de la dernière décennie, la jurisprudence de la Cour de justice ne s’est pas inscrite dans ce mouvement. Elle a en effet été émaillée d’arrêts et d’avis s’opposant à l’établissement ou au maintien de juridictions internationales. Cette jurisprudence est un contrepoint regrettable à la volonté politique de l’Union européenne de diffuser la justice dans l’ordre international. En somme, l’action de l’Union en faveur de la promotion de l’État de droit dans le reste du monde souffre d’une certaine inconstance.
Découvrez un extrait de sa communication :
Enfin, un livret interactif, valorisant l’ensemble des restitutions des trois journées que le Centre UniPaix a organisé – en février et août 2023 et cette dernière en septembre 2025, a été réalisé.

Un grand merci à toutes et tous pour votre présence !