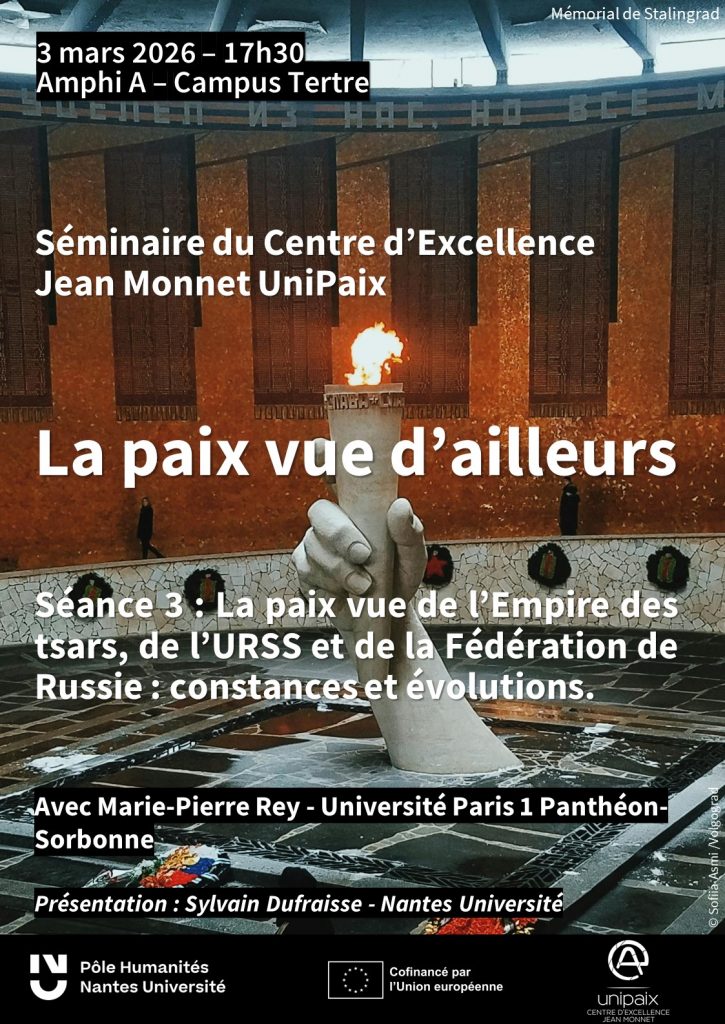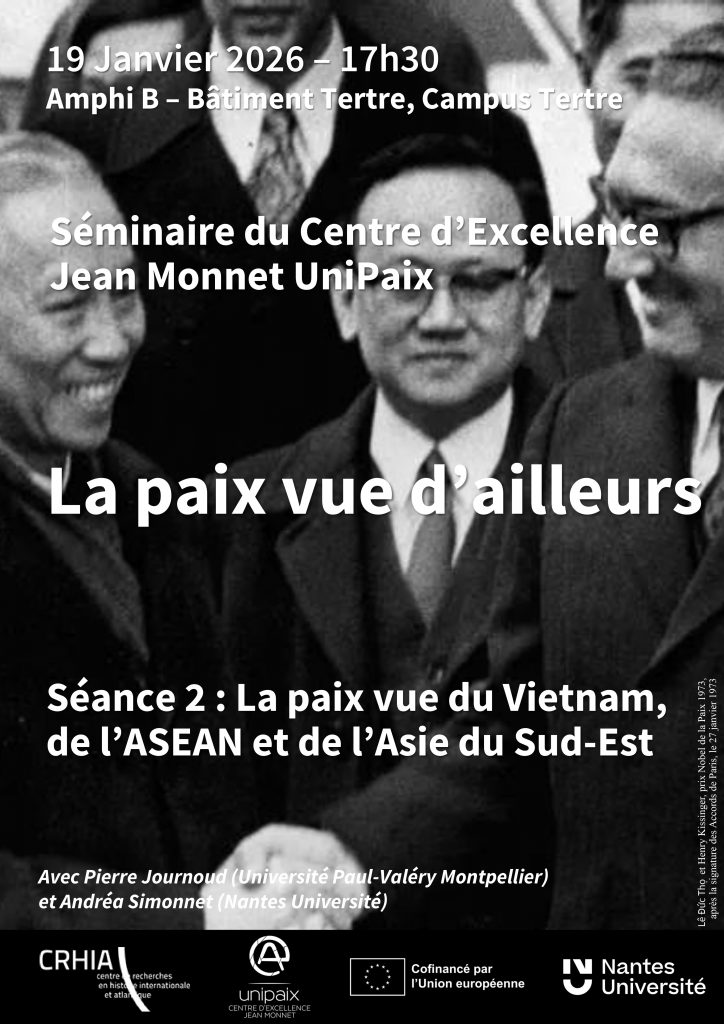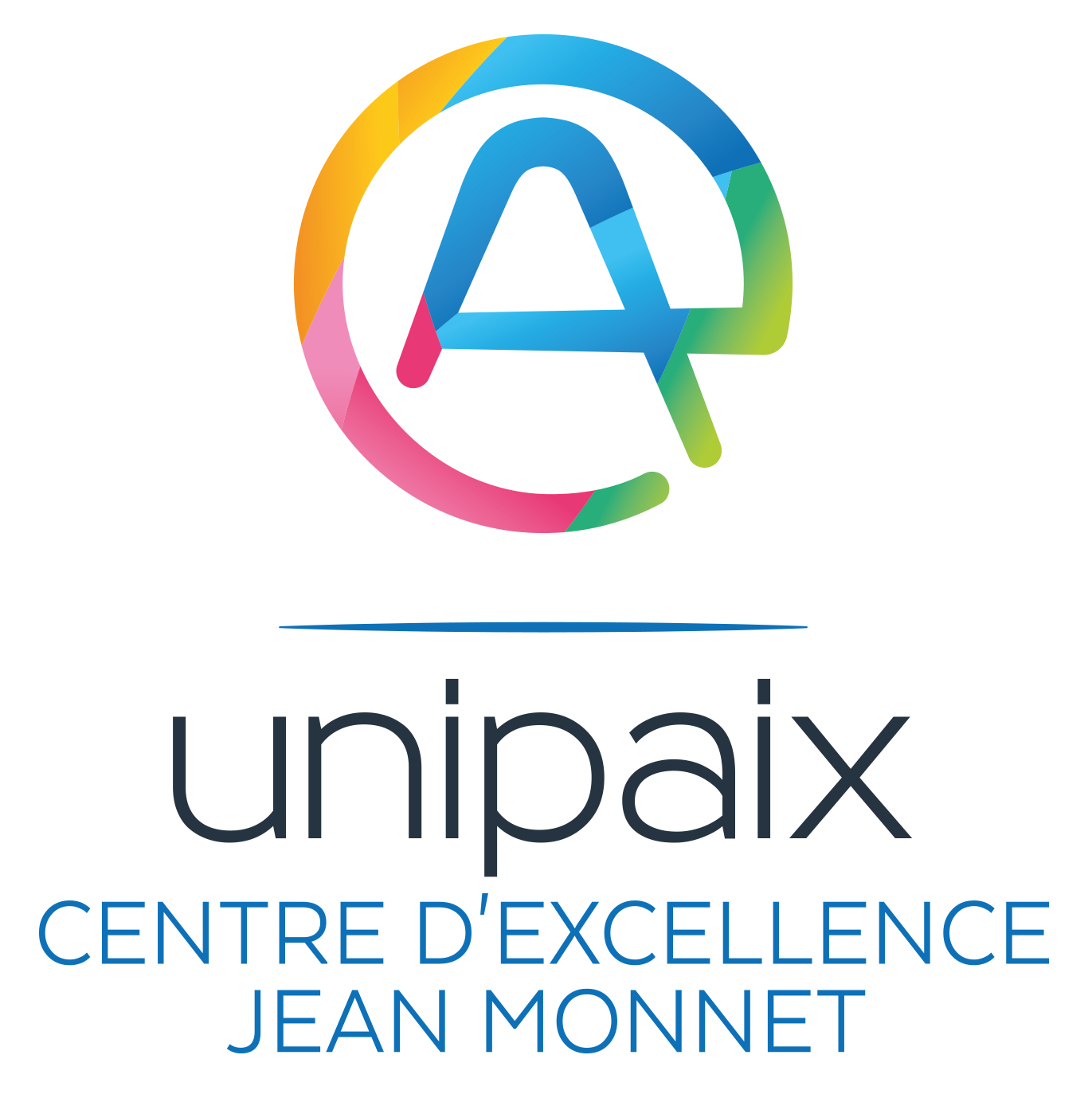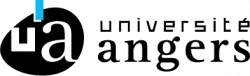Compte-rendu du colloque « la boite à outil de l’internationaliste dans la défense des intérêts communs » – « Axe 2 – Les sanctions internationales, outils de paix ? »
Les 30 et 31 aout derniers, le Centre Jean Bodin de l’Université d’Angers organisait, en parallèle des 150 ans de l’Institut de droit international et avec le soutien du CEJM UniPaix, un colloque relatif à la « boite à outils de l’internationaliste pour la défense des intérêts communs ». Cette manifestation fût l’occasion de réunir des juristes internationalistes du monde entier et de différentes générations pour débattre de la crise actuelle du droit international et des relations internationales. Les participants étaient unanimes : le droit international se situe à un tournant.
La crise de l’ordre juridique internationale est source de désordre, à l’heure où l’humanité fait face à des défis sans précédent. Cette recrudescence des désordres se manifeste notamment par un rejet de plus en plus important des normes internationales, comme en témoigne l’agression russe à l’égard de l’Ukraine qui montre que la guerre peut redevenir un instrument de politique nationale. La crise peut cependant constituer un laboratoire d’innovation pour le droit international, et permettre d’ébaucher de nouvelles solutions pour réguler les relations internationales.
Le colloque a mis en lumière l’élargissement de la boîte à outils dont les internationalistes disposent pour défendre les intérêts communs en mettant en question des concepts comme le contentieux stratégique, la notion d’intérêt à agir ou encore les modalités de participation au procès international. Face aux crises, des outils se développent, comme l’ont montré les discussions relatives aux « sanctions ». Si la crise engendrée par l’agression de l’Ukraine par la Russie met une nouvelle fois à nu le blocage du gardien de la paix qu’est le Conseil de sécurité des Nation unies, la vigueur avec laquelle les réactions unilatérales – à travers les « sanctions » – sont venues pallier la paralysie institutionnelle est sans précédents.
Cette pratique, qui doit être resituée dans la perspective plus large de l’articulation entre coercition multilatérale et unilatérale, semble s’inscrire dans la durée. Les sanctions massives et sans précédent adoptées par les États occidentaux et leurs « alliés » en réaction à l’agression de l’Ukraine par la Russie sont venues abonder une pratique déjà riche de mesures coercitives unilatérales. Aux questions déjà classiques et demeurées sans réponse, concernant par exemple celle de leur qualification juridique et de leurs limites en droit international, sont venues s’ajouter des interrogations nouvelles, issues de la pratique la plus récente.
Divisée en deux ateliers, l’après-midi a montré que les zones grises sur la question des « sanctions » n’avaient jamais été si nombreuses. Les discussions ont d’abord porté sur la compatibilité de sanctions avec l’ordre juridique international avant d’envisager la position du juge vis-à-vis de ces mesures unilatérales.
La première partie de l’après-midi envisageait la question de la qualification et de la compatibilité des sanctions unilatérales, qui ne cessent de se multiplier, avec le droit international. Si l’existence de ces mesures peut se justifier dans les blocages du système international, une vision cynique retient que la sanction unilatérale est une véritable mesure de politique étrangère, dont certains effets extraterritoriaux confinent parfois à l’universel. Nouvel avatar du pouvoir souverain de l’État affranchi des contraintes du système multilatéral pour les uns, seul moyen efficace de réagir à la violation de normes impératives de droit international pour les autres, l’expansion de la coercition unilatérale soulève d’épineuses questions d’articulation avec le rôle du Conseil de sécurité pour déterminer si ces dernières peuvent rétablir la paix.
Le premier atelier a d’abord tenté de mieux définir ces mesures et de déterminer, par exemple, si elles pouvaient être qualifiés de contremesures adoptées dans l’intérêt général. Les discussions ont aussi porté sur l’articulation de ces mesures avec la coercition multilatérale, alors que les paquets de sanctions adoptés l’égard de la Fédération de Russie sont coordonnées entre plusieurs États, ce qui constitue une nouveauté notable et pose la question de l’émergence d’un multilatéralisme des « alliances », qui prendrait la relève d’un multilatéralisme institutionnel sclérosé. La question se pose d’autant plus au regard de l’extraterritorialité de certaines mesures adoptées dans ce cadre et de la « surtransposition » des sanctions, qui vient renforcer l’efficacité des mesures unilatérales en tant qu’outil de projection de puissance de quelques acteurs clés.
Par ailleurs, la pratique des mesures coercitives unilatérales interroge aussi quant à la question du respect des droits fondamentaux des personnes ciblées et, plus largement, du respect des principes de l’État de droit. Les propositions de criminalisation du contournement des sanctions et de confiscation des biens gelés soulèvent des questions encore plus épineuses. Les discussions de la première partie de l’après-midi ont aussi porté sur la situation des tiers affectés par les sanctions, en rappelant que si les mesures unilatérales affectent les populations civiles des États vies, elles affectent aussi dans une certaine mesure les populations d’États tiers dans l’hypothèse de mesures d’embargo quasi généralisé. Il a été relevé la faiblesse de la mise en œuvre d’éventuelles exemptions humanitaires dans cette hypothèse.
La deuxième partie de l’après-midi traitait de la question des rapports entre la fonction juridictionnelle et les mesures coercitives unilatérales. On peut s’interroger sur les limites du contrôle juridictionnel de cet outil intrinsèquement politique que sont les « sanctions » unilatérales. Ces limites se révèlent lorsque les « sanctions » sont elles-mêmes soumises au contrôle juridictionnel et lorsqu’elles interfèrent avec d’autres procédures.
Les discussions ont ainsi porté sur le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne sur les sanctions ciblées. Le contentieux des mesures individuelles à l’égard de personnes ayant des liens avec le régime russe a permis à la Cour d’affiner sa jurisprudence déjà fournie sur la question. La Cour de Luxembourg a réaffirmé, à plusieurs reprises, que les mesures coercitives adoptées par l’Union européenne doivent respecter les fondements de l’Union de droit, et notamment la possibilité de contester les sanctions devant le juge. Les discussions ne se sont pas cantonnées au prétoire de la CJUE. La question de savoir si la Cour internationale de Justice pouvait être amenée à connaitre ce type de mesures a elle aussi été abordée.
Par ailleurs, la possibilité de contester les mesures restrictives ou leurs effets devant des tribunaux arbitraux en matière d’investissement, qui fait irruption de manière récurrente dans les médias, a été mise en perspective, de même que les implications des sanctions pour le droit international privé. En particulier, les discussions auront porté à la fin de l’après-midi sur les questions relatives à la surtransposition des sanctions par les acteurs privés ou celles touchant à la reconnaissance et à l’exécution des décisions juridictionnelles concernant des personnes visées par des sanctions.
Les enseignements des discussions se sont révélés nombreux. Il apparait d’abord qu’alors même qu’elles posent des problèmes de définitions et de qualification en droit international, les sanctions unilatérales existent et poursuivent le plus souvent un objectif louable. Toutefois, un minimum de régulation est nécessaire pour que ces outils s’insèrent de manière harmonieuse dans l’ordre juridique international. Les intervenants ont insisté sur le fait qu’un grand nombre de sanctions unilatérales opèrent au sein d’une forme de vide juridique, et qu’une clarification de régime juridique international des sanctions était plus que jamais nécessaire.
À cet égard, la production par la Cour internationale de justice d’un avis consultatif sur la question a été envisagée par les membres du panel. En réunissant à Angers des universitaires, des avocats, des diplomates ainsi que la Rapporteure spéciale des Nations unies sur les sanctions, la table-ronde sur les mesures coercitives unilatérales visait à stimuler le débat sur la question et à mieux faire connaitre au grand public toutes les questions soulevées par l’utilisation de ces outils comme instruments de politique internationale, ainsi qu’à mettre sur la table les différentes options en présence pour clarifier les règles du droit international qui leur sont applicables.