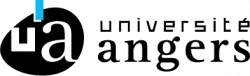Le colloque international « Représentation et mémoire de la migration » a eu lieu à Nantes les 24 et 25 mai 2018, dans le cadre du projet Citer. Kaja Skowronska, post-doctorante au CRHIA, présente ici les principales réflexions du colloque.
Ce colloque était organisé par Gwénola SEBAUX (Université catholique de l’Ouest Angers), Bettina SEVERIN-BARBOUTIE (Justus-Liebig Universität Gießen), Meryem YOUSSOUFI (Université Ibn Zohr Agadir), Zaihia ZEROULOU (Université Lille 1) et Dirk RUPNOW (Institut für Zeitgeschichte / Universität Innsbruck).
L’objectif premier était d’examiner l’articulation entre représentation et mémoire au prisme de l’immigration. Comme l’a rappelé Gwénola SEBAUX (Université Catholique de l’Ouest) dans son discours d’ouverture, cela implique une réflexion sur les liens entre passé et présent, car la manière de se représenter et de se remémorer les événements passés porte en elle une certaine vision de l’avenir commun. Cela signifie qu’un lien fort existe également entre ces problématiques et la question de la cohésion sociale. L’immigration est un objet particulièrement intéressant à cet égard. Depuis les années 2000 en Europe on cherche de plus en plus à mettre en avant la mémoire de l’immigration dans le discours public. Ces initiatives ont une dimension civique. La recherche scientifique et l’écriture de l’histoire s’y mélangent de manière particulièrement frappante avec la production de lieux de mémoire. Les représentations qu’on crée ainsi invitent nombre de questions : quel rôle jouent ces représentations dans la cristallisation de l’identité d’un groupe ? Quel rapport entretiennent-elles avec sa mémoire ? Quels événements ce groupe choisit-il de retenir et pourquoi ? Les interventions des deux journées de ce colloque apportent chacune un éclairage nouveau à ces questionnements.
Les difficultés propres aux tentatives de représenter l’immigration étaient au cœur du keynote donné par Dirk RUPNOW (Institut für Zeitgeschichte, Innsbruck). Parmi celles-ci, on peut d’abord compter la politisation du sujet, qui rend les termes mêmes du débat chargés politiquement et leur utilisation malaisée. Il faut également noter les lacunes et les silences de l’histoire. L’immigration est encore souvent un vide dans les mémoires collectives et le migrant paraît, selon la formule d’Alfred Schutz, comme un « homme sans histoire »[1]. De plus, dans cet examen de représentations de l’immigration, nos propres histoires scientifiques doivent être prises en compte : on doit réfléchir sur leurs tendances à se limiter aux cadres nationaux et sur le lien étroit qu’elles entretiennent avec l’essor des États-nations ainsi qu’avec l’établissement des empires coloniaux.
En même temps, on constate une nécessité évidente de représenter l’immigration pour donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Les initiatives qui vont dans ce sens font encore trop souvent l’économie d’une réflexion approfondie sur les significations qu’elles produisent. Il serait nécessaire de s’interroger davantage sur les acteurs à qui on donne la parole, sur leurs relations mutuelles et les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre eux. Cet élément en particulier a attiré l’attention du public à la suite de cette intervention, et la discussion a porté aussi bien sur les acteurs qui produisent les représentations des migrations, que sur le public auquel elles s’adressent.
L’intervenant souligna également qu’il est important de ne pas céder à l’illusion que pourrait créer l’apparition du terme « post-migration », à savoir que les processus examinés appartiendraient au passé plus qu’au présent. Ce terme a été l’objet d’un vif débat avec le public, révélant ainsi son ambiguïté : terme positif visant à inclure la migration dans les narrations nationales, il porte aussi un risque d’invisibilisation des migrations présentes.
Finalement, l’intervenant s’est demandé si l’on devait, à l’instar d’Edouard Glissant, s’interroger sur un droit à l’invisibilité : doit-on vraiment rendre visible ce qui différencie les migrant.e.s ? Ne serait-ce pas une manière de les mettre à l’écart ? Est-ce réellement ce que souhaitent les premiers intéressé.e.s ? On a remarqué, dans le débat qui a suivi, qu’un lien peut être établi entre cette idée et celle de la « post-migration » : si par le passé on mettait surtout l’accent sur l’indifférenciation, aujourd’hui on est passé à une recherche de visibilité, qui ne se situe pas forcément en fracture avec l’universalisme, mais s’inscrit dans une logique d’égalité réelle plutôt que formelle. Dans les deux cas, une tension existe entre la volonté de reconnaissance des voix des immigrés et le risque d’essentialisation qu’elle implique.
Toutes les interventions qui ont suivi ont montré des acteurs et des projets aux prises avec ces questions. Le lien entre le présent et le passé, la complexité des positionnements dans un paysage marqué par la politique, ou encore l’ambiguïté des termes et des concepts utilisés pour penser la mémoire de l’immigration étaient des thèmes récurrents. On peut organiser ces interventions autour de trois thématiques principales : premièrement les identifications et auto-identifications des acteur.rice.s ; deuxièmement, les discours eux-mêmes et l’écriture de l’histoire ; et troisièmement les institutions, les infrastructures et les espaces où ces narrations sont produites et diffusées.
Plusieurs interventions mettaient l’accent sur la complexité et la multiplicité des identifications. On y mettait en exergue les nombreux processus en jeu dans la production des identités : des assignations administratives, aux stratégies d’autoreprésentation choisies par les migrant.e.s, en passant par les injonctions contradictoires qui peuvent exister sur ce plan au sein d’une société.
Ces dynamiques sont présentes dans les interactions entre une communauté et l’administration publique. C’est le cas des Kurdes de Turquie installés dans l’Ouest de la France depuis les années 1970, qui étaient l’objet de la communication de Coline RONDEAU (Université d’Angers). Les qualificatifs et assignations utilisés par l’administration varient, et les Kurdes adoptent différentes stratégies pour y faire face. Un décalage peut exister entre les statuts assignés et les identités revendiquées, mais il faut également noter que la kurdicité n’est pas vécue de la même manière par tou.te.s. C’est ainsi qu’on aboutit à une certaine invisibilisation de cette communauté, et cela malgré des efforts de mise en visibilité menés par des « entrepreneurs de mémoire ».
La complexité et la multiplicité des identités se voient aussi dans les expériences et représentations des jeunes pavillonnaires racisés étudiés par Adrien BENAISE (Université de Lille 1). L’intervenant se basait sur une enquête qualitative dans deux communes limitrophes, dont l’une est une cité HLM et l’autre un quartier pavillonnaire. Il examinait ainsi les constructions identitaires dans un contexte de forte ségrégation sociale et spatiale. Les jeunes issu.e.s d’immigration extra-européenne vivant dans le quartier pavillonnaire sont objet de processus de racialisation et cherchent à négocier leur position dans ce contexte. Leur situation est celle d’un « entre-deux », à la frontière entre les deux groupes. Les attitudes et stratégies qu’elles et ils adoptent varient, mais la question qui persiste est de savoir comment ces jeunes pourront devenir des Français.es comme les autres. Un travail approfondi sur l’histoire de la France semble nécessaire pour l’accomplir.
C’est une position tout aussi complexe qu’occupe le groupe analysé par Gloria PAGANINI (Université de Nantes) : les « Nouveaux Italiens » de Nantes. Il s’agit de personnes de nationalité italienne issues de familles immigrées. Leur parcours est donc marqué par une double expérience de migration : d’abord celle de leurs parents vers l’Italie, et ensuite leur propre déplacement vers la France. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que ce deuxième départ soit dû à la crise économique, on se rend compte que ces personnes sont en général issues de familles durablement inscrites professionnellement en Italie. La décision de quitter l’Italie pour ces jeunes représente donc plutôt un déclassement temporaire, dans l’espoir d’une ascension future. De manière générale, il s’agit d’une décision prise par les parents. L’attitude de ces jeunes envers ce choix familial est marquée par une reconnaissance du sacrifice des parents et une valorisation du courage face aux défis de la migration. Il est dès lors important de s’interroger sur les effets psychologiques, et les effets sur le parcours des enfants, de ces idées et valeurs que ces jeunes souhaitent incarner.
Cet ensemble d’interventions examine ainsi la multiplicité et l’inventivité des identifications et des parcours des migrant.e.s et leurs descendant.e.s. En même temps, on note qu’elles et ils évoluent dans un contexte marqué par des assignations administratives parfois arbitraires, par la prégnance des processus de racialisation, et par un certain décalage entre les parcours réels et leurs perception dans l’espace public.
Ce dernier élément, à savoir les discours sur l’histoire et les perceptions des migrations existant dans l’espace public, était plus spécifiquement examiné dans une autre série d’interventions.
Ces discours peuvent parfois être plutôt un manque de discours, comme le montre l’intervention de Francesco PONGILUPPI (Université La Sapienza de Rome) sur l’émigration italienne en Méditerranée orientale. Peu d’études existent sur l’émigration italienne vers l’espace correspondant aujourd’hui à la Turquie, et cela malgré une importante communauté italophone résidant en Levant à partir de l’époque ottomane. La représentation de cette communauté est passée du mépris au mythe, et du mythe à l’oubli. La mythologisation de ce groupe était le fait des politiques nationalistes et colonialistes de l’Italie, et ensuite de la politique fasciste. C’est pour ces raisons que cette phase est suivie par une période de désengagement historiographique. Dans ce processus, l’hétérogénéité de ce groupe a également été oubliée. On voit donc ici la mémoire d’une communauté à la merci des facteurs politiques et géopolitiques du moment.
Un autre éclairage sur l’articulation entre un moment historique et l’immigration était offert dans la communication d’Onur ERDUR (Humboldt-Universität zu Berlin) sur les migrant.e.s en Allemagne au moment de la chute du mur de Berlin. Prenant comme point focal une photo célèbre d’un homme issu de l’immigration tenant une pancarte où l’on lit : « Nous sommes aussi le peuple », l’intervenant réfléchissait sur ce que la mémoire des communautés immigrées peut nous dire sur ce lieu commun de l’histoire en Allemagne. On découvre ainsi que cette révolution a eu pour résultat d’exclure une part de la population. Pour une partie des migrant.e.s et leurs descendant.e.s, la réunification a été vécue comme une période d’incertitude quant à leur appartenance à l’Allemagne et la possibilité d’y rester. Dans ce contexte, le fameux slogan de la photo pose la question de l’identité du peuple allemand : qui est le peuple ? Comment devient-on membre ? Comment cette nation se positionne-t-elle par rapport aux autres ? Cette notion de peuple, dont l’usage diffère entre l’Allemagne et la France, a donné lieu à un débat dans le public qui mettait en lumière la multiplicité des sens derrière les termes utilisés pour parler des identités collectives.
On voit ainsi apparaître la question du lien entre l’inclusion des migrant.e.s dans les récits d’histoire et leur inclusion réelle dans la société. Cette problématique d’inclusion était particulièrement bien visible dans la réflexion de Stefan GOCH (Universität Bochum) sur la migration dans l’espace social du bassin de la Ruhr. S’appuyant sur une étude statistique de la structure des milieux sociaux par ville, l’intervenant questionnait l’idée de la Ruhr comme creuset. En effet, la Ruhr est une région métallurgique, où historiquement la population nouvellement arrivée parvenait à s’inscrire. La vie était organisée autour de la métallurgie et les modes de vie se ressemblaient. Récemment, la différentiation se fait plus sentir et les statistiques le confirment. L’image de la Ruhr qui en ressort est celle d’une région désertifiée, où le capital humain est en train de disparaître. Cette différenciation des situations et conditions de vie est en lien avec l’histoire de l’immigration et il ne s’agit donc pas d’un modèle qui parvient à inclure tout le monde. Pour intégrer les populations immigrées dans les sociétés locales il serait nécessaire de mettre en place un État social actif et activiste.
Enfin, la présentation de Felix WIEDEMANN (Freie Universität Berlin) abordait la question des discours sur la migration par le biais des narrations dans l’écriture de l’histoire vers 1900. Elle explorait ainsi l’idée, présente aussi dans les interventions précédentes, que l’on observe toujours le passé à la lumière du présent. L’intervenant distinguait trois catégories de narrations de migration à cette période. La narration de fondation raconte l’appropriation d’un espace pour le développement d’une culture. Cette installation est vue comme un acte fondateur pour un pays ou une civilisation. Les histoires de la fin en sont en quelque sorte le pendant négatif : ici, les migrants viennent de l’extérieur et détruisent tout. Les récits de mélange donnent à voir le changement entraîné par la migration comme moteur du développement culturel. Cependant, il faut noter que même ce dernier type de récits n’est pas uniquement positif et que les migrant.e.s sont toujours vu.e.s à l’aune de ce qu’ils ou elles apportent dans ce mélange. Le lien entre récit du passé et perception du présent est d’autant plus frappant que certains de ces récits trouvent des parallèles avec les discours d’aujourd’hui.
La manière dont les migrations sont présentées dans les discours, racontées à travers les récits, et montrés ou invisibilisées dans les narrations nationales entretient donc un lien étroit avec la capacité d’une société à inclure les migrant.e.s et les descendant.e.s. De nos jours, nombre d’institutions et initiatives cherchent à promouvoir cette forme d’inclusion.
Les musées étaient la forme d’infrastructure de mémoire collective qui a le plus attiré l’attention des intervenant.e.s et une grande variété de cas, de formes et d’échelles a été examinée. Ainsi, Markus WALZ (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig) s’est penché dans sa présentation sur la spécificité des musées locaux et régionaux. Ces institutions sont organisées par cercles concentriques car les territoires auxquels elles sont consacrées s’imbriquent. Néanmoins, elles présentent toutes une rétrospective de ce qui est local : dans un tel musée, l’habitant.e local.e regarde vers le passé et y voit son histoire. C’est la cause de leur caractère exclusif. Le musée local présente l’histoire de ceux et celles qui sont « d’ici » et l’étranger.ère ne peut pas s’approprier ce qui y est présenté, ni s’y reconnaître. Les solutions pour sortir de cette tendance exclusive ne sont pas évidentes. Les tentatives d’inclusion, par exemple par la présence des objets liés à l’immigration, peignent souvent une image culturalisée des migrant.e.s et ne font que prolonger l’altérité. Une solution serait peut-être à chercher dans le glocal et consisterait à intégrer le contexte plus large dans l’histoire locale.
Le projet « Diversité au musée en focalisant sur les migrations et le genre » présenté par Verena LORBER et Michaela TASOTTI (Universität Salzburg) traite également de musées et expositions régionaux. Centrée sur six musées de Styrie, il offre un exemple de coopération entre des chercheuses et des responsables de musées. Son but est de questionner les stratégies et les pratiques muséales, pour mieux intégrer l’histoire de la migration dans les expositions.
L’intervention de Francesco FEDERICI (Università Iuav de Venise) se focalisait, quant à elle, sur des expositions individuelles plutôt que des musées entiers. Elle était centrée autour d’une comparaison entre deux expositions : « Faire les Italiens. Une exposition pour les 150 ans de l’Histoire d’Italie » à Turin et « Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France » au Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris. L’intervenant proposait ainsi une réflexion sur la façon de représenter l’Italie en Italie et en dehors de l’Italie. Bien que ces deux expositions mettent en œuvre des méthodologies muséales très différentes, il en ressort dans les deux cas une vision morcelée, fragmentaire du passé italien qui sert peut-être à montrer la complexité de l’identité nationale.
Le Musée National de l’Histoire de l’Immigration était aussi au cœur de la présentation de Sandrine LE CORRE (Université de Paris VIII), qui consistait en une analyse des œuvres d’art contemporain dans la collection de ce musée. Ces œuvres se caractérisent par ce que l’intervenante qualifié d’une « esthétique de l’entrevoir », présentant des images floues, incertaines, qui se dérobent à la lecture. Cette forme de représentation peut se positionner en rupture avec le but avéré du musée : rendre visible l’histoire de l’immigration. Mais cela peut aussi être une manière de refléter l’état d’entre-deux qui marque les expériences de migration et de questionner par-là la capacité d’un musée à donner à voir l’ensemble du vécu des migrant.e.s.
Alors que les interventions précédentes se focalisaient sur des cas précis, la communication de Hans Peter HAHN et Friedemann NEUMANN (Goethe-Universität Frankfurt) proposait une réflexion plus générale, tout en examinant plusieurs exemples concrets. De nos jours, les expositions sur le thème de la migration deviennent une des priorités de la politique culturelle, mais, selon les auteurs, jusqu’à maintenant les musées n’ont pas réussi à refléter de manière adéquate la migration. Cela peut être dû au lien fort existant entre musée et État-nation[2]. La tension entre le musée comme reflet de l’idée d’une nation homogène et la volonté d’y montrer la multiplicité n’est toujours pas résolue. Trois exemples étaient utilisés pour le montrer : le Musée Historique Allemand de Berlin avec une exposition intitulée « Immer Bunter » (« Toujours plus coloré ») ; le Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris ; et la Maison des émigrants allemands. Dans certaines de ces expositions on parvient à donner la parole aux migrant.e.s et à créer de l’empathie chez le public. Mais chacune de ces initiatives échoue d’une certaine manière. Le nationalisme méthodologique n’est jamais mis en question et le destin des migrant.e.s est toujours vu comme spécial, exceptionnel. On y trouve aussi une certaine essentialisation de la différence culturelle. L’idée que, à terme, les migrants doivent s’adapter à la société d’accueil est également très répandue, confirmant une vision de la nation homogène. Il ne s’agit donc pas, dans ces musées, d’un dépassement de frontières, mais d’une réification des différences. Pour surmonter cette impasse, il faudrait éviter d’assigner l’altérité aux migrant.e.s.
A côté des musées, un autre type d’institutions examinées étaient les archives et les centres de documentation. Sandra VACCA (DOMiD Köln) a ainsi exposé l’activité de DOMiD (Centre de documentation pour l’immigration en Allemagne) : une institution qui cherche préserver la mémoire de l’immigration en rassemblant des objets et recueillant des témoignages. Cette présentation offrait notamment une réflexion sur la définition d’un objet de migration, qu’elle voyait surtout comme un objet avec une histoire, ouvert à l’interprétation. Ainsi, il est possible que beaucoup de musées disposent déjà des collections de l’immigration sans le savoir, car c’est le regard qu’on porte dessus qui fait un objet de migration. Un autre défi pour ce type d’institutions est le rapport de confiance qu’il est nécessaire d’établir avec les populations concernées.
Ce thème est revenu également dans la présentation de Jürgen LOTTERER (Stadtarchiv Stuttgart) sur les archives municipales. L’intervenant a commencé par mentionner quelques difficultés liées à la prise en compte des migrations dans ce contexte. S’il existe des documents officiels concernant les migrant.e.s, et des documents produits par des associations, le sujet reste peu visible au niveau de la représentation non-officielle. Cela signifie le manque de représentation de certaines fractions de la société. C’est ce qui explique le rôle crucial, dans l’agrandissement des archives, des « cultural brokers », c’est-à-dire des personnes qui ont une certaine compétence interculturelle grâce à laquelle elles aident les autres à traverser les frontières culturelles. C’est souvent sur ces personnes, intégrées et actives dans les associations, que repose le succès des initiatives d’archivage.
Ces institutions, bien que cruciales, ne sont pas les seuls espaces où l’on produit des représentations des migrations. D’autres acteurs sont présents et d’autres initiatives, souvent moins formelles, existent.
Les médias peuvent être des acteurs clés de ce processus de production de représentations. L’intervention de Constantin ECKNER (University of St. Andrews) a fourni un bon exemple de la manière dont les médias – et en particulier la presse écrite – peuvent chercher à se situer par rapport au sujet des migrations. En examinant la presse ouest-allemande dans les années 80, l’intervenant a montré que les médias passent par des phases alternatives : après avoir pris conscience du phénomène, ils le commentent, puis cherchent à se situer comme influenceurs et donner forme au débat.
Cependant, de nos jours, les médias traditionnels ne sont pas les seuls à influencer les réactions du public vis-à-vis l’immigration. Comme l’a rappelé Naima AABCHANE (Université Ibn Zohr Agadir), les nouveaux médias permettent une vision de l’actualité plus immédiate, sans intermédiaires. Cela n’est pas sans risques, comme l’illustre le cercle vicieux qui semble s’être installé entre les médias sociaux, les politiques et le public concernant les migrations. L’image qui prévaut depuis quelque temps est celle d’une « crise des migrants », s’accompagnant d’images déshumanisantes, qui amplifient l’impression d’une situation d’exception. On peut dès lors s’interroger sur la possibilité d’un impact positif de ce type de médias. En l’état actuel, leur rôle dans la création des représentations de la migration reste hautement ambigu.
L’exemple des médias sociaux nous rappelle que la représentation des migrations se fait aussi « par en bas ». C’est également le cas des initiatives décrites dans la présentation de Janine SCHEMMER (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt). Cette intervention était focalisée sur les pratiques quotidiennes et artistiques dans la région du Frioul, à la frontière entre la Slovénie et l’Italie. Il s’agit d’une région qui se dépeuple et où la migration est surtout présente par l’absence de ceux et celles qui sont partis. Dans ce contexte, certaines personnes originaires du Frioul y retournent pour chercher à préserver la mémoire de la région et lui donner une visibilité. Des festivals et des projets artistiques se sont notamment mis en place. Bien que cela ne résolve pas les problèmes économiques qui poussent les habitant.e.s à l’émigration, ce genre d’efforts permet de recueillir leurs témoignages, et de placer cette périphérie au centre des attentions européennes.
Dernièrement, la présentation d’Albrecht SONNTAG (ESSCA School of Management, Angers) explorait les représentations des migrations dans l’espace particulier qu’est le monde du football. Il s’agit d’un domaine où la mémoire est extrêmement importante et qui possède une certaine puissance symbolique. C’est aussi un domaine où les migrations sont fréquentes et les personnes issues de l’immigration nombreuses. Ainsi, un débat sur la place des migrant.e.s dans le football a depuis les années 80 accompagné le débat plus général sur l’immigration dans les pays européens. On remarque que de plus en plus de personnes partagent une perception positive des joueur.euse.s issu.e.s de l’immigration, ce qui pourrait contribuer à l’intégration sociale des populations immigrées.
Le colloque s’est accompagné de la projection du court-métrage documentaire « Traversées de la mémoire » d’Erika THOMAS (Université Catholique de Lille et Université d’Artois), sélectionné dans la catégorie Meilleur Court Métrage Documentaire au Festival Amnesty International Au Cinéma pour Les Droits Humains (PACA Languedoc Corse mars 2018).
Pour conclure, plusieurs points centraux peuvent être relevés :
- L’idée d’un lien entre le présent et le passé, entre mémoire du passé et représentations du présent, soutenait l’ensemble des communications de ce colloque.
- Une forme particulière de ce lien semble être la source de nombre de difficultés auxquelles se confrontent les tentatives de représenter les migrations dans l’espace public. En effet, une part importante des acteurs en présence – musées, archives, institutions culturelles – prennent leurs racines dans un passé national et entretiennent un lien de parenté avec l’idée d’État-nation. Les discussions de ce colloque ont donc souvent abordé la tension qui existe entre ce cadre national et la volonté de parler de la diversité et du mouvement. L’évolution historique, qui a mené à la création des institutions mobilisées aujourd’hui pour parler des migrations, les ancre dans l’époque du nationalisme et les a longtemps poussé à négliger la mobilité.
- Les migrations sont pourtant un fait humain, omniprésent non seulement de nos jours, mais à travers l’histoire. Les représenter revient donc non pas tant à ajouter un nouvel élément aux faits connus, qu’à intégrer dans nos imaginaires une part du réel longtemps occultée. Plutôt que de créer des cadres spécifiques pour la représentation des migrations, la solution pourrait donc peut-être consister à les inclure dans les récits existants, de parler de ce qui dans nos sociétés est mobile et non seulement de ce qui est stable. Cela impliquerait aussi de restituer le contexte large dans lequel les migrations se produisent et d’explorer les liens entre l’histoire des nations européennes et celle des migrant.e.s. C’est donc un véritable désapprentissage des modes de pensée reçus qui serait nécessaire. A l’heure actuelle, il semble que ce processus est encore loin d’être accompli.
- Cela est d’autant plus important que le lien entre le passé et le présent va dans les deux sens. Si on lit toujours le passé à la lumière du présent, ce sont les idées qu’on se fait du passé qui fournissent les grilles de lecture du présent. Il est donc crucial de s’interroger sur ce que nos récits et imaginaires de l’histoire donnent à voir et ce qu’ils rendent invisible. Les représentations ainsi produites peuvent, en effet, avoir des conséquences très réelles dans la vie des migrant.e.s et leurs descendant.e.s aujourd’hui.
[1] Schutz, Alfred, L’étranger : un essai de psychologie sociale, Paris, Éditions Allia, 2003.
[2] Anderson, Benedict, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, 1996